A l’heure où, après avoir tenté de revendre sans succès sa filiale Opel, le groupe General Motors ferme une usine de la marque allemande à Anvers, l’historien Jacques Pauwels revient sur les relations certes lucratives mais peu honorables du géant automobile américain avec l’Allemagne nazie. En 1929, GM achète Opel et réalise rapidement de plantureux bénéfices sous le régime hitlérien. Qualifié de “miracle du 20ème siècle” par les patrons de l’entreprise automobile US, le Führer mène en effet une politique de réarmement, de lutte contre les syndicats et de bas salaires pour de longues heures de travail qui profite directement à GM via sa filiale Opel. Mais qu’advient-il de ses relations fructueuses lorsque les Etats-Unis s’engagent dans le conflit contre l’Allemagne ? « Business as usual » comme nous l’explique Jacques Pauwels… (Investig’Action)
Déjà en 1929, c’est-à-dire voici environ quatre-vingts ans, l’entreprise américaine General Motors (GM) achetait le plus important fabricant automobile allemand, Adam Opel AG, dont la principale usine se trouvait (et se trouve toujours) à Rüsselsheim, près de Francfort-sur-le-Main. Toutefois, en cette même année 1929, éclatait la grande crise économique internationale qui allait frapper l’Allemagne avec une sévérité particulière. Le marché automobile allemand s’effondrait et Opel subissait de lourdes pertes. Des bénéfices commencèrent cependant à rentrer après qu’Hitler fut venu au pouvoir, en 1933. À cela, deux raisons importantes. Primo, les nazis démantelèrent les syndicats et menèrent une politique de bas salaires et de longues heures de travail, ce qui fit que les coûts salariaux d’Opel – tout comme ceux des autres entreprises allemandes – baissèrent remarquablement[i]. Secundo, Hitler lança un programme à grande échelle de réarmement, de sorte qu’Opel reçut à la pelle des commandes de camions et autres véhicules militaires pour l’armée. La production atteignit des sommets et la filiale de GM devint extrêmement rentable. Pour 1938, par exemple, on nota des bénéfices de 35 millions de RM[ii]. Fin 1939, la valeur d’Opel était estimée à 86,7 millions de dollars, soit plus du double de la valeur initiale des investissements allemands de General Motors, d’un montant de 33,3 millions de dollars[iii].
Ne soyons donc pas étonnés si les patrons de GM aux États-Unis admiraient Hitler et le portaient aux nues en le qualifiant de « miracle du 20e siècle » (William Knudsen, président de General Motors de 1937 à 1940[iv]) et de « dirigeant fort, occupé à sortir le peuple allemand du désert de son ancienne misère économique, non pas par la violence et la terreur, mais avec un planning intelligent et une façon fondamentalement saine de gouverner » (Alfred P. Sloan, président de General Motors de 1923 à 1937,) dans la revue General Motors World[v]). À l’instar de nombreux autres industriels américains, Sloan offrit d’énormes quantités d’argent aux groupements fascistes et quasi fascistes des États-Unis mêmes, par exemple, au Ku Klux Klan[vi]. Et, en Allemagne même, Opel fit octroyer un soutien financier royal au parti d’Hitler, le NSDAP.
Sous le régime hitlérien, Opel embraya sur la production exclusive de matériel destiné à l’armée allemande. D’une part, les autorités nazies avaient insisté en ce sens mais, d’autre part, ce cours nouveau avait été activement recherché par les patrons d’Opel en Allemagne et de GM aux États-Unis et c’est pourquoi ils l’accueillirent avec enthousiasme. La production de matériel militaire assurait en effet des bénéfices qui, paraît-il, étaient de 40 pour 100 supérieurs aux bénéfices engendrés par le matériel civil[vii].
Quelle sorte de matériel GM produisait-il pour Hitler en Allemagne ? Dans une nouvelle usine Opel fondée à Brandebourg, près de Berlin, il ne sortait rien d’autre de la chaîne que des camions de trois tonnes du modèle Blitz, « Éclair », destinés à la Wehrmacht. On les a décrits comme le moyen de transport par excellence des troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, l’usine Opel de General Motors à Rüsselsheim – qui disposait de pas moins de 96 bandes courantes, d’une longueur totale de près de 12 km ! – produisait pour la Luftwaffe des avions comme le JU-88, le cheval de trait de la flotte allemande de bombardiers, mais aussi des composantes de torpilles pour la marine de guerre allemande[viii]. Soit dit en passant, les avions de la Luftwaffe pouvaient atteindre des vitesses élevées grâce à un ingrédient ajouté à leur carburant : le tétraéthyl synthétique. Cette composante était fabriquée par une firme du nom d’Ethyl GmbH, une filiale de GM en partenariat avec Standard Oil of New Jersey (aujourd’hui Exxon) et le partenaire allemand de Standard Oil, IG Farben[ix]. Hitler était particulièrement satisfait de la contribution fournie par Opel à ses préparatifs de guerre et il le prouva en faisant décerner une distinction honorifique prestigieuse à James D. Mooney, le manager qui, chez General Motor, était chargé des exportations vers l’Allemagne et de la production en Allemagne[x].
Avec la production massive de camions et d’avions, GM contribua via Opel et Ethyl GmbH aux victoires d’Hitler dans sa « guerre éclair » en 1939 et 1940. Les patrons de GM n’en éprouvèrent toutefois pas le moindre sentiment de culpabilité. Au contraire, ils s’en enorgueillirent car, dans un certain sens, les victoires d’Hitler étaient également les leurs. Et, de toute façon, ils préféraient de loin les dictatures comme celle d’Hitler, de Mussolini, de Franco, etc. aux États démocratiques dans lesquels les socialistes et les syndicats pouvaient avoir leur mot à dire. En juin 1940, au moment de la chute de la France, Sloan fit ouvertement savoir qu’il se réjouissait des victoires du fascisme, avec ses « dirigeants forts, intelligents et agressifs », sur les démocraties européennes « décadentes », selon lui[xi]. Quand les nazis fêtaient leurs triomphes, GM y participait. Le 26 juin 1940, le collègue de Sloan, Mooney, était présent – et bien en vue – lors d’une fête à l’hôtel Waldorf-Astoria où la communauté allemande locale de New York fêtait les victoires d’Hitler en Pologne et en Europe occidentale[xii].
En 1940, les États-Unis étaient encore neutres et la production au profit de l’Allemagne nazie n’équivalait donc pas à une production au profit d’un ennemi de la patrie. Mais qu’advint-il d’Opel, après que, dans la foulée de Pearl Harbor, les États-Unis entrèrent en guerre contre l’Allemagne d’Hitler ? La réponse à cette question est simple : business as usual, les affaires, comme d’habitude !
Après Pearl Harbor, Opel ne fut pas confisquée mais resta entièrement la propriété de GM[xiii]. Les administrateurs délégués allemands en place – des hommes de confiance des patrons aux États-Unis – continuèrent à tenir les rênes, à diriger les firmes et, ce faisant, pensèrent surtout aux intérêts de la maison mère en Amérique. L’intervention des nazis dans la gestion journalière d’Opel resta minimale. Ce n’est que le 25 novembre 1942 que Berlin désigna pour Opel un « gestionnaire de propriété ennemie » (Feindvermögensverwalter), mais la signification de cette décision se révéla purement symbolique. Les nazis ne voulaient rien de plus que procurer « une image de marque allemande » à une firme qui était à cent pour cent la propriété de General Motors et qui le resta également durant toute la guerre[xiv].
Pourquoi les nazis furent-ils si tolérants ? Pour pouvoir continuer à faire la guerre après l’échec de leur stratégie de « guerre éclair » en Union soviétique et pour reporter le plus longtemps possible la défaite finale désormais inévitable, ils avaient un insatiable besoin d’avions, de camions et de chars et, en Allemagne, c’est par Opel et d’autres filiales des sociétés américaines – y compris la grande usine de Ford à Cologne – que ce matériel était produit le plus efficacement à grande échelle. Depuis qu’Henry Ford avait inventé la chaîne de production et autres méthodes « fordistes » d’accroissement de la productivité, les firmes américaines étaient en effet les leaders incontestés dans le domaine de la production industrielle de masse. Les planificateurs nazis comme Speer ne comprenaient que trop bien que des changements radicaux dans la gestion d’Opel à Brandebourg et Rüsselsheim pourraient déranger. Les administrateurs délégués existants purent continuer à prospérer parce qu’ils étaient habitués aux méthodes de production particulièrement efficaces des Américains ; c’était l’unique façon pour Opel de pouvoir continuer à produire un maximum. Les quotas de production élevés qui avaient été définis par Berlin étaient même régulièrement dépassés, de sorte que les nazis décernèrent à la filiale allemande de General Motors le titre honorifique particulièrement clinquant de « firme exemplaire dans la production de matériel de guerre » (Kriegsmusterbetrieb)[xv]. Pour les nazis, la production d’Opel n’était pas importante que sur le plan quantitatif, elle l’était aussi sur celui de la qualité. Du matériel militaire fabriqué par Opel pendant la guerre faisait également partie des armes d’excellente qualité, par exemple des camions munis d’un système de propulsion sur toutes les roues (all-wheel-drive) qui se révélèrent particulièrement utiles dans la boue du front de l’Est et dans les sables du désert nord-africain, des trains d’atterrissage modernes pour les avions et, vers la fin de la guerre, des moteurs pour le flambant neuf Me-262, le tout premier chasseur à réaction[xvi]. La chercheuse allemande Anita Kugler en est venue à la conclusion qu’Opel « a entièrement mis sa production et sa recherche à la disposition des nazis et qu’objectivement, la firme les a aidés à prolonger la guerre durant un long laps de temps[xvii] ».
Après Pearl Harbor, Opel continua non seulement à produire à plein rendement en Allemagne nazie, mais aussi à enregistrer des bénéfices élevés. Un historien américain, Henry Ashby Turner, parle de « flux croissant des bénéfices » et, en résultante, « une réserve de capital de plus en plus importante qui, vers fin 1942, s’élevait à plus d’un quart de milliard de Reichsmark[xviii] ». Selon une autre source, les bénéfices d’Opel crevaient tellement le plafond que les nazis en interdirent la publication. Ils le firent afin d’éviter la colère du simple citoyen allemand à qui l’on demandait de plus en plus de se serrer la ceinture et qui se rendait sans doute compte que les bénéfices de cette filiale d’une entreprise américaine ne profitaient en aucun cas aux « camarades du peuple allemand » (Volksgenossen), pour utiliser la terminologie nazie[xix].
Les bénéfices d’Opel pendant la guerre étaient dus à la production élevée et au fait que Berlin continuait à payer sans rechigner les factures pourtant salées, mais aussi à la politique de bas salaires des nazis déjà mentionnée. Pendant la guerre, il fallait travailler plus longtemps pour gagner moins, et il en allait de même dans les filiales allemandes des entreprises américaines. Chez Opel, dès mai 1940, les travailleurs furent mis au travail au moins 60 heures par semaine et, dans un même temps, leurs salaires furent diminués. À Rüsselsheim, la semaine de travail devint de plus en plus longue, de sorte que, fin 1942, les travailleurs devaient s’échiner 66 heures par semaine[xx]. Durant la guerre, chez Opel, les coûts salariaux purent cependant encore être réduits grâce à l’incorporation de travailleurs forcés, surtout des prisonniers de guerre et des déportés, y compris des femmes et des enfants, en provenance de l’Union soviétique. La mise au travail de ces « esclaves » allait de pair, semble-t-il, avec « une exploitation maximale, les plus mauvais traitements possibles et même… la peine de mort dans le cas de petits larcins[xxi] ». (Il y a une dizaine d’années, Opel décida volontairement de cotiser au fonds créé par le gouvernement allemand pour dédommager quelque peu les travailleurs forcés étrangers qui, pendant la guerre, avaient trimé dans les usines allemandes et parmi lesquels relativement peu avaient survécu. Félicitons ici la firme pour ce geste[xxii].)
Les bénéfices accumulés par Opel en Allemagne durant la guerre s’élevaient à la fin du conflit à 22,4 millions de RM. Après la guerre, GM reprit officiellement possession d’Opel et, en 1951, l’entreprise fit main basse sur ce petit pactole qui, entre-temps, vu les réformes monétaires de l’après-guerre, avait fondu et ne représentait « plus que » 261.061 dollars. Or, le fait d’avoir réclamé cette somme relativement modeste suffit, comme le fait remarquer Turner, « à considérer General Motors coupable d’avoir réalisé des bénéfices en utilisant des travailleurs forcés pour la production de matériel de guerre au profit du IIIe Reich[xxiii] ». Une part considérable des bénéfices d’Opel avait toutefois déjà été réinvestie en Allemagne même, au cours de la guerre, par exemple dans l’extension des équipements de production mêmes et dans la reprise (en 1942) d’une fonderie de Leipzig qui, depuis longtemps, produisait des blocs moteurs pour Opel[xxiv].
Pendant la guerre, GM engrangea également de faramineux bénéfices aux États-Unis mêmes. Une vague de commandes de matériel militaire de la part de l’État, pour une valeur de 13,4 milliards de dollars, rapporta à l’entreprise un bénéfice de 673 millions de dollars[xxv]. Il fut particulièrement utile qu’au lendemain de Pearl Harbor, le gouvernement américain confia à d’innombrables représentants du big business des postes importants à Washington, ce dont ces hommes d’affaires tirèrent parti pour enlever dans la foulée de lucratives commandes d’État et, bien sûr aussi, pour prendre à cœur dans la mesure du possible les intérêts des filiales de firmes américaines en Allemagne – tout en s’arrangeant pour qu’aux États-Unis mêmes, le public n’en sût pas grand-chose, voire rien du tout. William S. Knudsen qui, en 1937, avait succédé à Alfred P. Sloan comme président de General Motors et avait conservé ce poste jusqu’en 1940, devint directeur du fameux Office of Production Management, une sorte de ministère supervisant la fabrication et l’achat de matériel de guerre en tout genre, y compris les sortes de véhicules produits par hasard par General Motors. (Le fait que, dans les années trente, Knudsen passait pour un admirateur inconditionnel d’Hitler et un ami de Göring, n’avait manifestement pas la moindre importance.)
L’influence du big business dans les hautes sphères gouvernementales de Washington explique aussi pourquoi les filiales allemandes des entreprises américaines ne furent jamais les objectifs des bombardements systématiques des Alliés et ce, malgré le fait que leur production était d’une importance plus que capitale pour la machine de guerre nazie. Bernard Baruch, un conseiller haut placé du président Roosevelt, avait donné l’ordre de ne pas bombarder – ou très, très superficiellement – certaines usines en Allemagne. Nous ne sommes donc guère surpris de retrouver sur sa liste les filiales des sociétés américaines. Contrairement à l’importante usine de Ford à Cologne, celle d’Opel à Rüsselsheim fut bel et bien bombardée, mais cela n’eut lieu que très tard dans la guerre, le 20 juillet 1944, et, à l’époque, les principaux équipements de production avaient déjà été transférés depuis longtemps à la campagne, dans ce qu’on appelait une Auslagerung (un dépôt à l’extérieur)[xxvi]. Le bombardement fit d’ailleurs relativement peu de dégâts et on prétend que dix pour cent à peine de l’infrastructure fut détruite. En tout cas, la production battait toujours son plein lorsque, le 25 mars 1945, les soldats américains atteignirent Rüsselsheim[xxvii]. Toutefois, après la guerre, GM exigea sans vergogne et avec succès des compensations de l’État américain pour les dommages subis par Opel lors des bombardements anglo-américains. L’entreprise reçut 33 millions de dollars, en partie sous forme de crédits d’impôt. En parlant de crédits d’impôt, en 1941, GM était parvenu à déclarer perdus ses investissements en Allemagne, c’est-à-dire Opel, ce qui lui avait rapporté un crédit d’impôt d’environ 23 millions de dollars. En théorie, ceci conférait au gouvernement américain le droit de confisquer Opel après la guerre. En lieu et place, en 1948, General Motors se vit très gentiment proposer la possibilité de récupérer ses investissements en Allemagne en échange d’un paiement de 1,8 million de dollars, ce qui revenait à un crédit d’impôt de près de 21 millions de dollars.[xxviii]
De nos jours, les affaires de GM ne tournent pas très bien en Allemagne. Entre 1933 et 1945, d’autre part, grâce à Hitler et grâce à la guerre déclenchée par celui-ci, GM put faire des affaires en or de l’autre côté du Rhin. Pour la plupart des Européens, l’époque du nazisme se résuma à des années très pénibles mais, pour GM, elle ne fut rien d’autre que the good old days – « le bon vieux temps » !
Source: www.investigaction.net
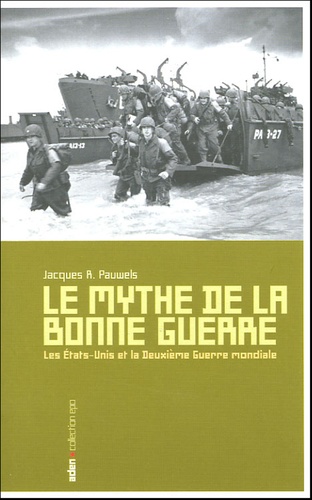 Jacques Pauwels est historien est auteur du livre Le mythe de la bonne guerre dont une nouvelle édition paraîtra bientôt chez les Editions Aden A Bruxelles. L'ouvrage a également fait l'object d'une adaption en film documentaire en français: A Good War.
Jacques Pauwels est historien est auteur du livre Le mythe de la bonne guerre dont une nouvelle édition paraîtra bientôt chez les Editions Aden A Bruxelles. L'ouvrage a également fait l'object d'une adaption en film documentaire en français: A Good War.
Notes:
[i] Reinhold Billstein, Karola Fings, Anita Kugler & Nicholas Levis, Working for the Enemy : Ford, General Motors, and Forced Labor during the Second World War, New York et Oxford, 2000, p. 25.
[ii] Billstein et al., p. 24 ; Stephan H. Lindner, Das Reichskommissariat für die Behandlung feindlichen Vermögens im Zweiten Weltkrieg : Eine Studie zur Verwaltungs-, Rechts- en Wirtschaftsgeschichte des nationalsozialistischen Deutschlands, Stuttgart, 1991, p. 121.
[iii] Edwin Black, IBM and the Holocaust : The Strategic Alliance between Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation, Londres, 2001, pp. 76-77, 86-87, 98, 119-21, 164-98, 222 ; Henry Ashby Turner, Jr., General Motors and the Nazis: The Struggle for Control of Opel, Europe’s Biggest Carmaker, New Haven/CT et Londres, 2005, p. 12.
[iv] La citation de Knudsen est tirée de Charles Higham, Trading with the Enemy : An Exposé of The Nazi-American Money Plot 1933-1949, New York, 1983, p. 163 ; voir également Volker Berghahn, « Writing the History of Business in the Third Reich : Past Achievements and Future Directions », dans : Francis R. Nicosia et Jonathan Huener (éd.), Business and Industry in Nazi Germany, New York et Oxford, 2004, pp. 142 et ss.
[v] Edwin Black, Nazi nexus : America's corporate connections to Hitler's Holocaust, Washington/DC, 2009, pp. 101-02.
[vi] Black, 2009, pp. 109-10.
[vii] Black, 2009, pp. 104.
[viii] Billstein et al., p. 25 ; Black, 2009, pp. 104-05 ; Anita Kugler, « Das Opel-Management während des Zweiten Weltkrieges. Die Behandlung ‘feindlichen Vermögens’ und die ‘Selbstverantwortung’ der Rüstungsindustrie », dans : Bernd Heyl et Andrea Neugebauer (éd.), « …ohne Rücksicht auf die Verhältnisse » : Opel zwischen Weltwirtschaftskrise und Wiederaufbau, Francfort-sur-le-Main, 1997, pp. 35-38, 40 et ss. ; Anita Kugler, « Flugzeuge für den Führer », Deutsche « Gefolgschaftsmitglieder » und ausländische Zwangsarbeiter im Opel-Werk in Rüsselsheim 1940 bis 1945 », dans : Bernd Heyl et Andrea Neugebauer (éd.), « …ohne Rücksicht auf die Verhältnisse » : Opel zwischen Weltwirtschaftskrise und Wiederaufbau, Francfort-sur-le-Main, 1997, pp. 69-92 ; Helms, Hans G. « Ford und die Nazis », dans : Komila Felinska (éd.), Zwangsarbeit bei Ford, Keulen, 1996, p. 113 ; Turner, 2005, pp. 41 et ss., 92-99; Philipp Gassert, « Handel mit Hitler », Die Zeit, mars 1999, http://images.zeit.de/text/1999/03/Handel_mit_Hitler.
[ix] Walter Hofer et Herbert R. Reginbogin. Hitler, der Westen und die Schweiz 1936–1945, Zürich, 2002, p. 589 ; Agostino von Hassell et Sigrid MacRae, avec Simone Ameskamp, Alliance of Enemies : The Untold Story of the Secret American and German Collaboration to End World War II, New York, 2006, p. 223 ; Anthony C. Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler, Seal Beach/CA, 1976, pp. 53-54 ; citation tirée de Black, 2009, pp. 107-08.
[x] Description de Mooney en tant que « ministre des Affaires étrangères », dans von Hassell et MacRae, p. 67.
[xi] Black, 2009, p. 115.
[xii] Higham, pp. 97, 171 ; Ed Cray, Chrome Colossus : General Motors and its Times, New York, 1980, p. 315 ; Anthony Sampson, The Sovereign State of ITT, New York, 1973, p. 82 ; Charles Whiting, Hitler’s Secret War : The Nazi Espionage Campaign against the Allies, Londres, 2000, pp. 43-44.
[xiii] Helms, p. 114 ; Billstein et al., pp. 74, 141.
[xiv] Billstein et al., p. 61. Plus sur Opel dans Turner, 2005, pp. 127 et ss.
[xv] Billstein et al., p. 81 ; Kugler, « Das Opel-Management », pp. 52, 61 et ss., 67 ; Kugler, « Flugzeuge », p. 85 ; Turner, 2005, p. 142.
[xvi] Snell, « General Motors and the Nazis », Ramparts, 12 juin 1974, pp. 14-15 ; Kugler, « Das Opel-Management », pp. 53, 67 ; Kugler, « Flugzeuge », p. 89 ; Higham, pp. 175-76 ; Friedman, John S. « Kodak's Nazi Connections », The Nation, 26 mars 2001, http://thenation.com/doc/20010326/friedman.
[xvii] Cité dans Billstein et al., p. 81.
[xix] Billstein et al., p. 73 ; Kugler, « Das Opel-Management », pp. 55, 67 ; Kugler, « Flugzeuge », p. 85.
[xx] Turner, 2005, p. 144 ; Kugler, 1997b, pp. 71, 86 ; Billstein et al., pp. 45-46. À propos du sort des travailleurs allemands pendant la guerre en général, voir Harald Focke et Uwe Reimer, Alltag unterm Hakenkreuz : Wie die Nazis das Leben der Deutschen veränderten, Reinbek bei Hamburg, 1979, pp. 166-69.
[xxi] Kugler, « Das Opel-Management », p. 57 ; Kugler, « Flugzeuge », pp. 72-76, citation de p. 76 ; Billstein et al., pp. 53-55 ; Turner, 2005, pp. 145-46.
[xxii] Von Hassell et MacRae, p. 109.
[xxiii] Turner, 2005, pp. 147-49, 158.
[xxiv] Communication à l’auteur de la part de A. Neugebauer des Archives de la Ville de Rüsselsheim, 4 février 2000 ; Lindner, pp. 126-27. Voir également :
http://www.ebn24.info/functions/print_b.php?id=116&sprach_id=2&link=page-3.id-116.sprach_id-.projekt-.land-.st_id-.seite-2.set_lang-2.
[xxv] David Farber, Sloan rules : Alfred P. Sloan and the Triumph of General Motors, Chicago et Londres, 2002, p. 223.
[xxvi] Black, 2001, pp. 406-09.
[xxvii] Billstein et al., pp 77-79 ; Heyl et Neugebauer, pp. 170-80. 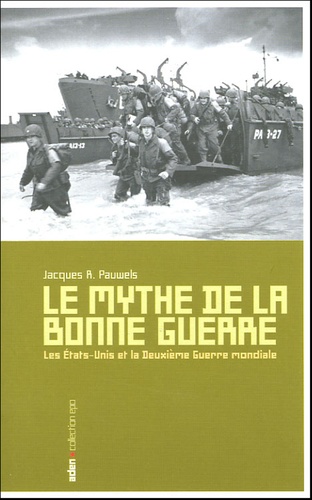 Jacques Pauwels est historien est auteur du livre Le mythe de la bonne guerre dont une nouvelle édition paraîtra bientôt chez les Editions Aden A Bruxelles. L'ouvrage a également fait l'object d'une adaption en film documentaire en français: A Good War.
Jacques Pauwels est historien est auteur du livre Le mythe de la bonne guerre dont une nouvelle édition paraîtra bientôt chez les Editions Aden A Bruxelles. L'ouvrage a également fait l'object d'une adaption en film documentaire en français: A Good War.