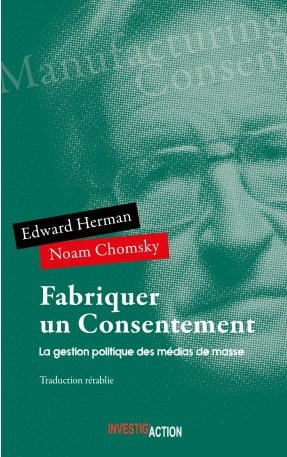La lecture de Manufacturing Consent de Herman et Chomsky, alors que j’étais étudiant, ne m’avait pas préparé à ce que j’ai vu lors de mon premier voyage au Venezuela. Mes amis vénézuéliens m’avaient prévenu que la description que faisaient les médias mainstream du pays sous Hugo Chávez déformait grossièrement les faits sur le terrain, mais en regardant les chaînes de télévision nationales et CNN la nuit du 11 avril 2002, je n’en croyais toujours pas mes yeux.
J’étais à Caracas depuis à peine 48 heures. La veille, deuxième jour de la « grève générale » lancée par l’opposition, je m’étais promené dans différents quartiers et j’avais été frappé par deux réalités distinctes. Dans les quartiers aisés de l’est de la ville, les commerces étaient fermés et les rues étaient vides, tandis que les quartiers ouvriers, plus pauvres, étaient animés.
Tôt le 11 avril, je me suis dirigé vers l’Autoroute Guaicaipuro pour observer la marche massive de l’opposition. La plupart des marcheurs que j’ai vus avaient le teint clair et portaient des vêtements à la mode. Certains tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Chávez = Ben Laden » et appelaient les États-Unis à intervenir, comme ils l’avaient fait en Afghanistan quelque six mois plus tôt. La marche devait se terminer au siège de PDVSA, la compagnie pétrolière d’État, pour protester contre la décision de Chávez de licencier les principaux dirigeants de l’entreprise. Mais soudain, j’ai entendu quelqu’un annoncer dans un mégaphone que la marche se dirigeait désormais vers le palais présidentiel de Miraflores pour « jeter Chávez dehors et l’envoyer à Cuba ».
J’ai sauté dans le métro pour rejoindre Miraflores avant la marche et je me suis rapidement retrouvé au milieu d’une foule immense de chavistes à la peau foncée, probablement issus des quartiers pauvres des environs. Certains brandissaient des bâtons, d’autres s’agrippaient à des copies bleues, au format de poche, de la Constitution vénézuélienne de 1999. Ils ont crié qu’ils allaient défendre le palais, et la nouvelle constitution, au prix de leur vie.
Peu de temps après, la marche est arrivée. Certains des marcheurs ont jeté des pierres et des bouteilles sur une ligne de soldats de la garde présidentielle qui leur bloquait le passage et ont finalement été repoussés par des nuages de gaz lacrymogènes. J’ai alors entendu un bruit sec, comme un feu d’artifice, et un homme qui se tenait à côté de moi est tombé au sol, le sang jaillissant de son cou. Quelques personnes ont attrapé ses jambes et ses bras et ont couru avec son corps pour essayer de trouver de l’aide, mais il était manifestement trop tard. Un homme dans la foule a crié « snipers ! » et a montré du doigt une personne sur le toit d’un grand bâtiment à proximité. Dans la demi-heure qui a suivi, j’ai vu d’autres corps mous, dont le sang s’écoulait des blessures à la tête et à la poitrine, être transportés devant moi.
À peu près au même moment, des agents de la fameuse police métropolitaine de Caracas ont été vus en train de tirer des coups de fusil sur une foule de chavistes rassemblés sur le Puente Llaguno, à un demi-pâté de maisons du palais. Alors que tout le monde se mettait à l’abri, deux hommes ont sorti de petits pistolets et ont tiré sur les agents de police, bien qu’ils semblaient hors de portée. Après quelques heures, les choses se sont calmées. Les manifestants et les agents de la police métropolitaine ont quitté les lieux, les ambulances sont venues chercher les morts et les blessés, et nous avons tous fini par nous éloigner, hébétés et incertains de ce qui s’était passé.
En regardant la télévision avec mes amis vénézuéliens plus tard dans la soirée, nous avons été stupéfaits par ce que nous avons vu. Les chaînes vénézuéliennes, CNN et d’autres chaînes internationales ont diffusé en boucle des images de deux « pistoleros » de Puente Llaguno, sans montrer ce sur quoi ils tiraient. Ils ont tous rapporté que Chávez avait ordonné à ses sbires d’ouvrir le feu sur une marche pacifique, tuant 10 personnes ou plus. Des officiers supérieurs de l’armée lui avaient demandé de démissionner, ce qu’il avait fait, bien qu’aucune lettre de démission vérifiée n’ait jamais été produite. Un gouvernement de transition a été mis en place, dirigé par le président de Fedecámaras, la chambre de commerce. Les commentateurs de l’actualité étaient en liesse, tout comme le département d’État dans ses déclarations du lendemain : Le Venezuela était enfin sur la bonne voie.
Ce n’est que bien plus tard que le coup d’État éphémère a été docilement reconnu comme tel par les médias et le gouvernement des États-Unis. Mais à ce moment-là, ils étaient passés à d’autres narratifs faussés sur le pays.
Je m’étais rendu au Venezuela en tant que touriste politique, m’attendant à y passer quelques semaines pour en apprendre davantage sur le mouvement populaire à l’origine du processus bolivarien. Après avoir vécu le coup d’État du 11 avril et l’étonnant soulèvement populaire qui a contribué à ramener Chávez au pouvoir, j’ai abandonné mes études supérieures en France et j’ai fini par vivre à Caracas pendant six ans, en faisant divers petits boulots, dont celui de conseiller en relations internationales de Chávez. Pendant tout le temps où j’étais là-bas, j’ai continué à observer deux réalités alternatives, qui coexistaient en quelque sorte. Dans l’une, les membres des classes moyennes et supérieures se considéraient comme la société civile, luttant pour restaurer la démocratie et la liberté par tous les moyens nécessaires. L’autre réalité se trouvait dans les communautés à faible revenu qui avaient été abandonnées par l’État pendant des décennies et qui ressentaient maintenant un sentiment de pouvoir et d’action au sein d’une démocratie beaucoup plus inclusive.
En dehors du Venezuela, c’est la première de ces deux réalités qui a façonné le récit dominant que l’on retrouve dans les médias et dans le discours des gouvernements occidentaux, en particulier le gouvernement états-unien. Le scénario de base était que Chávez était un dictateur en herbe, un « Castro-communiste » qui avait permis aux Cubains de prendre le contrôle de l’appareil de sécurité et de renseignement du pays. Peu importe que lui et son parti gagnent continuellement des élections compétitives et transparentes ; le gouvernement Chávez était une menace pour la liberté et la démocratie au Venezuela et, d’ailleurs, dans le reste de l’Amérique latine.
Et donc, les dirigeants de la société civile étaient justifiés de soutenir la rébellion militaire. Ils étaient également justifiés dans leur effort pour forcer Chávez à quitter le pouvoir en paralysant l’industrie pétrolière et en déclenchant une dépression économique, comme ils l’ont fait fin 2002 et début 2003. Ayant perdu le référendum de 2004 sur la révocation de Chávez, ils étaient également fondés à boycotter les élections législatives de 2005, affirmant que le système électoral était « truqué » en leur défaveur. Ayant ensuite perdu pratiquement tous leurs sièges à l’Assemblée nationale, ils étaient en droit d’affirmer que Chávez et son parti contrôlaient toutes les branches du gouvernement et que, par conséquent, le Venezuela n’était plus vraiment une démocratie.
Les responsables états-uniens et les principaux médias ont adopté cette vision, tout en ne voyant et ne reconnaissant que rarement, voire jamais, l’autre réalité du Venezuela, celle des barrios – quartiers populaires. De temps en temps, l’un des correspondants étrangers les plus courageux rapportait certains faits gênants qui contribuaient à expliquer la popularité durable de Chávez : comment les politiques sociales et économiques de son gouvernement avaient considérablement réduit la pauvreté et fourni à des millions de personnes un accès gratuit aux soins de santé, aux programmes d’alphabétisation et à l’enseignement supérieur pour la première fois. Mais aucun grand média n’a parlé de ce qui se passait de vraiment passionnant dans les barrios : la démocratie participative.
Il y avait les comités de terre urbaine et les équipes populaires de gestion de l’eau, dans lesquels les habitants des quartiers à faibles revenus travaillaient ensemble à l’élaboration de plans d’amélioration des logements et des infrastructures d’eau et d’assainissement. Il y avait les cercles bolivariens, des groupes locaux qui discutaient et débattaient longuement de la nouvelle constitution du Venezuela et des dernières nouvelles lois. Et il y avait les conseils de planification locale, qui sont devenus plus tard des conseils communaux, où les membres des communautés locales concevaient et supervisaient des projets financés par l’État pour améliorer les quartiers. Ces organes sont apparus dans de nombreux quartiers de la classe moyenne également.
Cette extraordinaire ruche d’organisation communautaire dans les barrios (quartiers populaires) – qu’elle soit promue par le gouvernement vénézuélien ou initiée par les communautés elles-mêmes – a reçu peu d’attention de la part des médias internationaux et en reçoit toujours peu à ce jour. De même, lorsque des centaines de milliers d’habitants de barrios sont descendus dans la rue pour défendre le projet bolivarien ou socialiste, ils sont généralement ignorés par la presse, alors que les marches et les rassemblements de l’opposition, quelle que soit leur taille, font l’objet de reportages quasi systématiques, présentés comme des mouvements pro-démocratie, quel que soit le véritable programme de l’opposition. Lorsque les manifestations de rue de la droite ont été violentes – comme cela s’est produit avec les guarimbas (barrages et violences de rue) délibérément violentes de 2004 et 2014 -, les gros titres finissent toujours par être une version de « manifestations pacifiques brutalement réprimées par le régime vénézuélien ».
Bien que le Venezuela ait beaucoup évolué depuis que j’y ai vécu dans les années 2000, le récit dominant aux États-Unis et dans le monde est toujours façonné par les élites internationales du pays et, de plus en plus, par les secteurs durs et de droite de la société vénézuélienne, dont beaucoup vivent maintenant dans le comté de Miami-Dade, en Floride. Cela a entraîné des distorsions et des omissions extrêmes dans les informations qui parviennent à la plupart des gens aux États-Unis et dans le monde.
On peut pardonner aux lecteurs et aux téléspectateurs des informations grand public de croire que le président autoproclamé Juan Guaidó se battait pour une transition pacifique et démocratique au Venezuela, alors qu’en réalité, lui et ses associés ont ouvertement tenté de provoquer un coup d’État militaire et appelé à une intervention militaire étrangère. On peut également leur pardonner de ne pas savoir que, même si le président Nicolás Maduro a mené certaines politiques qui ont endommagé l’économie vénézuélienne, de multiples études montrent que ce sont les dures sanctions économiques des États-Unis imposées pour la première fois en 2017 qui expliquent de manière significative l’effondrement rapide de l’économie depuis lors.
Tout comme pendant les années Chávez, le meilleur antidote au barrage continu de désinformation sur le Venezuela est de voir la réalité – ou les réalités parallèles – de ses propres yeux, par exemple en rejoignant une mission d’enquête. Grâce à un mouvement de solidarité dynamique et dévoué aux États-Unis qui s’est formé après le coup d’État de 2002, des délégations de militants de tous horizons continuent de se rendre au Venezuela, passant souvent du temps dans les barrios et les zones rurales reculées où peu de journalistes internationaux, voire aucun, ne mettent les pieds. Pour mieux comprendre la réalité qui se cache derrière les gros titres alarmants et sensationnels et voir comment les communautés continuent de s’organiser et de trouver des solutions collectives face aux sanctions états-uniennes et à d’autres défis énormes, envisagez de faire le voyage. Je vous garantis que vous en ressortirez profondément inspiré.
Vous pourriez même finir par rester un peu.
L’auteur : Alexander Main est directeur de la politique internationale au CEPR Center for Economic and Policy Research, Washington DC.
Source originale: NACLA
Traduit de l’anglais par Venezuela Infos
Retrouvez Fabriquer un consentement
sur notre boutique en ligne