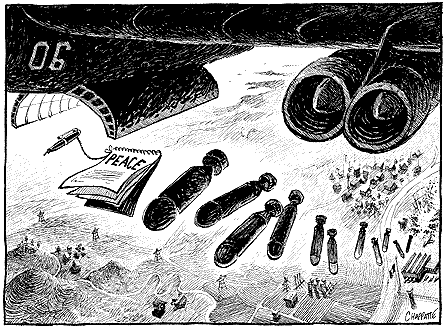Forte d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU prévoyant l’instauration d’une zone de non-vol pour protéger les civils, l’intervention militaire en Libye était-elle légale? Cette résolution a-t-elle simplement été interprétée de manière extensive ou bien a-t-elle été tout bonnement violée? Les motifs invoqués pour déclencher l’opération sont-ils conformes aux normes du droit international ou consacrent-ils une loi du plus fort qui n’aurait rien de nouveau?
Robert Charvin est juriste international, professeur émérite de droit à l’Université de Nice Sophia-Antipolis et doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Nice. Il analyse les motivations et les conséquences de l’intervention en Libye à la lumière du droit international. Ce texte n’est pas particulièrement court mais nous vous en recommandons vivement la lecture: il vaut bien une petite impression si nécessaire! (IGA)
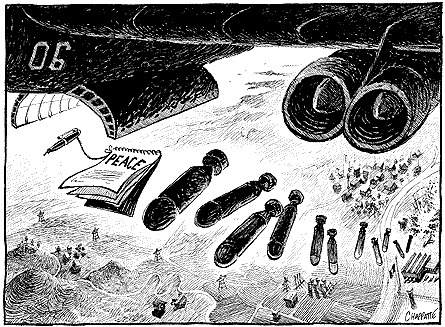
L’Europe est aujourd’hui la seule force capable de porter un projet de civilisation (…) L’Amérique et la Chine ont déjà commencé la conquête de l’Afrique. Jusqu’à quand l’Europe attendra-t-elle pour construire l’Afrique de demain ?
Nicolas Sarkozy. 2007.
Les insurgés libyens méritent l’aide de tous les démocrates.
Bernard-Henry Lévy. 2011.
Quand un peuple perd son indépendance face à l’extérieur, il ne garde pas longtemps sa démocratie à l’intérieur.
Régis Debray. 1987.
Une vague « morale » internationale, proche de celle régnant au XIX° siècle, est invoquée par les puissances occidentales alors qu’il est fait silence sur le droit international qu’elles considèrent – au mieux- comme un simple faisceau de procédures.
Cette « morale », produit occidentaliste de substitution, se concilie parfaitement avec la violation flagrante des principes fondamentaux constituant le cœur de la Charte des Nations Unies et avec un mépris ouvert vis-à-vis de l’ONU lorsque le Conseil de Sécurité, organe oligarchique est neutralisé par les divisions entre les grandes puissances et qu’il ne peut être en l’occurrence, instrumentalisé par certaines d’entre elles.
Les États-Unis, la France, la Grande Bretagne se considèrent toujours comme la « seule force capable de porter un projet de civilisation », tout en s’opposant lorsque leurs intérêts économiques et financiers ne coïncident pas.
Les opérations militaires ainsi que les ingérences indirectes se multiplient. Anders Fogh Rasmussen, Secrétaire Général de l’OTAN, les annonce lui-même : « Comme l’a prouvé la Libye, on ne peut pas savoir où arrivera la prochaine crise, mais elle arrivera » (5 septembre 2011).
L’inquiétude manifestée par les États du Sud authentiquement indépendants n’est pas prise en compte. Les paroles de Thébo Mbeki, ancien Président d’Afrique du Sud sont significatives : « Ce qui est arrivé en Libye peut très bien être un signe précurseur de ce qui peut arriver dans un autre pays. Je pense que nous devons tous examiner ce problème, parce que c’est un grand désastre » (20 septembre 2011).
Par contre, en France, une quasi unanimité s’est manifestée pour applaudir aux opérations de guerre menées contre la Libye, ainsi qu’à l’exécution sommaire de M. Kadhafi. De B.H. Lévy au Président Sarkozy, via Ignacio Ramonet, de l’UMP au PCF (bien qu’avec quelques réserves) via le PS, ainsi que tous les grands médias (de Al Jazeera au Figaro), on a « au nom d’un massacre seulement possible, perpétré un massacre bien réel, alimenté une guerre civile meurtrière » [1]et admis la violation d’un principe essentiel toujours en vigueur, la souveraineté d’un État membre des Nations Unies.
Il en a été de même dans la plupart des États occidentaux qui n’ont pas porté le moindre intérêt aux propositions de médiation de l’Union Africaine ou du Venezuela ni voulu confier à l’ONU la responsabilité d’une négociation ou d’une conciliation.
L’esprit de guerre s’est imposé dans l’urgence sans réaction d’une opinion non concernée en raison de la disparition de l’armée de conscription et de la professionnalisation (voire de la privatisation au moins partielle comme en Irak) des conflits armés.
Si la gauche française n’a pas manifesté son opposition alors qu’elle l’a fait dans le passé contre diverses agressions occidentales, c’est, qu’au-delà du « démocratisme » de rigueur, il s’agissait d’Africains et d’Arabes et de problèmes du « Sud », non électoralement rentables, en considération de l’état idéologique moyen des Français à la fin du mandat de N. Sarkozy [2].
Si la droite, particulièrement les conservateurs français, opte pour des ingérences de plus en plus ouvertes dans les pays du Sud, c’est, qu’au-delà des intérêts économiques (notamment énergétiques) des grands groupes installés dans le Sud, les aventures extérieures sont toujours bienvenues en période de crise intérieure grave.
Le résultat global c’est, sinon la mise à mort du droit international, du moins sa mise en état de coma dépassé [3].
1. L’inéligibilité de la Libye kadhafiste au bénéfice du droit international
Véritable cas d’école sur un continent où les élections sont en général des mascarades, les élections présidentielles en Côte d’Ivoire de 2010, faussées par une rébellion armée de plus de huit ans assistée par la France et occupant la partie Nord du territoire, ont donné lieu à une intervention des Nations Unies et de l’armée française visant à éliminer par la force le Président Gbagbo. L’occupation totale de la Côte d’Ivoire par la rébellion en 2011, avec l’appui de l’ONUCI et des troupes françaises de la Licorne, ponctuée de massacres (comme celui de Duékoué) n’a suscité que peu de réactions des juristes français [4]. Les prétextes avancés par les autorités françaises (répression contre les manifestants civils, non respect du résultat des « élections ») semblent avoir convaincu la doctrine dont la domination sur la pensée juridique évite de procéder aux vérifications nécessaires des allégations politiques officielles [5]. Ainsi, au nom d’une « légitimité démocratique » indéfinie, approuvée par la majorité conjoncturelle du Conseil de Sécurité, « stimulée » par un Etat juge et partie, il est désormais admis qu’un régime puisse être renversé par la force et qu’il en soit établi un autre, avec l’appui d’une partie belligérante.
Survenant à quelques mois d’intervalles, l’intervention en Libye s’inscrit dans la stratégie menée en Côte d’Ivoire et n’a que peu à voir avec la politique d’appui tardif aux mouvements populaires de Tunisie et d’Égypte [6].
Brutalement, au nom d’une menace visant les opposants au régime jamahiriyen dont Rony Brauman a montré le caractère improbable, la Libye s’est vue retirée sa qualité de sujet de droit international à part entière, de « membre régulier » de la communauté internationale. Il a suffi d’une manifestation le 15 février 2011 dans une ville du pays suivie d’une émeute le 17 dans cette même ville de Benghazi pour qu’un État membre de longue date des Nations Unies, ayant occupé la présidence de l’Union Africaine et conclu de nombreux accords avec différents États, en particulier la France et l’Italie, soit mis au ban de la société internationale. Le Conseil de Sécurité s’est satisfait de sources très partielles sur les événements de Benghazi : celles de l’une des parties en cause (les insurgés) et d’un média, Al-Jazeera [7], sans procéder à une investigation contradictoire et sans rechercher une « solution par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation (…) ou par d’autres moyens pacifiques » (article 33 de la Charte).
C’est dans une extrême précipitation [8] que le Conseil de Sécurité a adopté la Résolution 1970 du 26 février, soit quelques jours seulement après le début des événements de Benghazi, alors que de nombreux conflits dans ne monde ne suscitent que des réactions très tardives [9]. Les observations de l’Inde regrettant le fait « qu’il n’existait pratiquement aucune information crédible sur la situation sur place » n’ont pas été prises en compte. L’Etat libyen a été immédiatement considéré comme coupable et M. Kadhafi devait relever sans examen contradictoire des faits de la Cour Pénale Internationale !
Se répétait, à l’instigation de la France, des Etats-Unis et de la Grande Bretagne, malgré l’abstention de la Chine, de la Russie, de l’Inde, du Brésil et de l’Allemagne, la pratique suivie à propos de l’Irak, contre laquelle « toutes les preuves étaient réunies », comme celles prétendument fournies par Colin Powell en 2003, pour que Tripoli soit détruite, comme l’avait été Bagdad.
La Résolution 1973 du 17 mars complète la 1970 du 26 février.
Leur fondement est le « devoir de protéger les populations civiles », sans que le Conseil de Sécurité ne néglige de rappeler « son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance » de la Libye.
Son but est de « faire cesser les hostilités » et « toutes les violences ».
Les méthodes recommandées pour y parvenir sont de « faciliter le dialogue » tout en instaurant un contrôle de l’espace aérien pour éviter l’intervention de l’aviation libyenne.
C’est l’OTAN, puis essentiellement, sous son égide, la France et la Grande Bretagne, qui se chargent de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité.
Tous les éléments d’un arbitraire étranger à la légalité internationale étaient réunis.
En premier lieu, le flou extrême des résolutions. Le « devoir de protéger préventivement des populations civiles » s’apparente à la notion de « légitime défense préventive » qui n’est que le contournement de l’interdiction de l’agression. De plus, la notion de « civils » est imprécise. Quid du statut des « civils » armés ?
La violence du verbe de M. Kadhafi n’est pas assimilable à une répression illégale. La notion de « légitimité démocratique » explicitement utilisée par le Conseil de Sécurité pour condamner le régime Gbagbo en Côte d’Ivoire est la référence implicite permettant de juger le régime libyen comme étant non démocratique et source d’une menace pour la paix internationale. Le Conseil de Sécurité et les puissances occidentales se font ainsi les juges de la « validité » des régimes politiques dans le monde.
On peut souligner tout d’abord que ces résolutions 1970 et 1973 sont d’une nature contradictoire. Elles font référence à la souveraineté et à la non ingérence tant en « autorisant » les Etats membres des Nations Unies à prendre « toutes mesures nécessaires » pour la protection des civils, « tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen », étant entendu que les seuls vols autorisés au-dessus du territoire sont « d’ordre humanitaire » !
En second lieu, ces résolutions disant tout et leur contraire (les Nations Unies n’ont jamais mis en place le Comité d’état major et la police internationale prévus par la Charte), créent les conditions d’une intervention de l’OTAN dont les déclarations officielles et les objectifs évoluent très vite de la dimension « protectrice » à la dimension destructrice du régime de Tripoli.
De facto, le Conseil de Sécurité, d’un outil de conciliation et de maintien de la paix, devient un instrument de guerre. La Déclaration commune Sarkozy, Obama, Cameron du 15 avril 2011 est significative : « il ne s’agit pas d’évincer Kadhafi par la force », mais « tant que Kadhafi sera au pouvoir, l’OTAN … doit maintenir ses opérations » !
Le recours à la force armée aérienne et aux bombardements intensifs (poursuivis pendant plus de huit mois) sur les villes et les voies de communication n’ont qu’une seule finalité : assister le CNT de Benghazi et liquider le régime de Kadhafi, avec la promesse d’une contrepartie pétrolière à l’issue du conflit [10].
L’intervention terrestre, formellement interdite par le Conseil de Sécurité, s’est produite avant même le début des frappes aériennes. Le Rapport du CIRET-AVT et du Ct 2R précité atteste de la présence de membres de certains services spéciaux occidentaux (notamment la DGSE), puis par l’action militaire de certains groupes de « bi-nationaux » venus de différents pays occidentaux, dans l’Ouest du pays, profitant notamment d’une frontière tuniso-libyenne ouverte. Les livraisons d’armes (notamment françaises, via la Tunisie) sont devenues progressivement massives. Il s’avère aussi que des troupes venant du Qatar sont intervenues.
De manière significative, le gouvernement français n’a pratiquement jamais fait référence au droit international. La légalité selon lui s’est réduite à une mesure procédurale : la caution du Conseil de Sécurité, dont on sait que les résolutions échappent à tout contrôle de légalité !
Le paradoxe est que l’invocation permanente des droits de l’homme, de la démocratie et de l’humanitaire en général ne fonctionne pour les États occidentaux que de manière sélective. Si cette pratique n’est pas neuve, elle est devenue flagrante.
Concernant le monde arabe, tout particulièrement, les postures des États-Unis, de la France, de la Grande Bretagne relèvent de la caricature qu’il s’agisse de leurs politiques unilatérales ou de leurs comportements au sein du Conseil de Sécurité et plus généralement des Nations Unies.
C’est ainsi que la question kurde, celle du statut de la minorité chiite dans les pays du Golfe, celle des régimes de l’Arabie Saoudite, de Bahreïn [11] et des Émirats dont le Qatar, allié militant de l’OTAN contre la Libye, ne suscitent aucune réaction : à leur propos, les droits de l’homme et la démocratie ne font l’objet d’aucune interrogation occidentale [12] !
Le plus flagrant est le cas de la Palestine. Deux ou trois États au Conseil de Sécurité paralysent le soutien de la majorité absolue des États membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies à l’admission de la Palestine comme membre ordinaire de l’ONU. Au nom d’une certaine « conception » de l’humanitaire, les États-Unis et la France (à sa façon) [13]s’opposent à la pleine reconnaissance de l’État palestinien, car elle « pourrait conduire à une relance de la violence, obstacle majeur à la négociation avec Israël » ! Après un demi-siècle d’hostilité et d’indifférence, les États occidentaux considèrent que le Peuple palestinien doit encore attendre. Leur soutien spectaculaire aux « révolutions arabes » n’a donc rien à voir avec une position de principe. « On ne peut pas à la fois saluer l’avènement de la démocratie dans le monde arabe, et s’en désintéresser quand cela concerne la question nationale palestinienne », écrit à juste titre B. Stora [14].
La « sensibilité » au monde arabe et à l’Islam est donc à géométrie variable pour les autorités occidentales. Ce sont les intérêts en jeu qui conditionnent tout. Le droit humanitaire et les droits de l’homme n’ont rien à y voir.
La guerre de Libye a lourdement malmené le droit humanitaire. La « protection des populations civiles » est demeurée une notion abstraite au détriment des Libyens transformés en victimes des bombardements, du racisme et de la xénophobie, en miliciens armés par l’étranger ou par l’État, en personnes déplacées fuyant les lieux de combat. Un phénomène de fuite hors du territoire libyen de centaines de milliers de travailleurs étrangers, dans les pires conditions de précarité, s’est ajouté dans une quasi indifférence des États occidentaux et dans l’impuissance des États voisins.
Les opérations de l’OTAN dont la force de frappe a été constituée par l’armée française, son aviation et ses services spéciaux, n’ont en rien respecté le droit humanitaire, quelles que soient les réactions de vertu outragée d’un Juppé lorsqu’on « ose » lui signaler les victimes civiles libyennes des bombardements de l’OTAN [15] !
Le rapport Libye : un avenir incertain. Compte rendu de mission d’évaluation auprès des belligérants libyens (Paris, mai 2011) établi par une délégation d’experts (dont Y. Bonnet, ex-directeur de la DST), sur lequel les médias ont fait un silence quasi absolu [16], a constaté que la révolution libyenne n’est pas une révolte pacifique, que les « civils », dès le 17 février, étaient armés et qu’ils ont attaqué les bâtiments civils et militaires de Benghazi : il n’y a pas eu en Libye de grandes manifestations populaires pacifiques réprimées par la force !
C’est de manière préventive que l’intervention extérieure a eu lieu, soit moins de 10 jours après les premiers incidents et c’est dès le 2 mars, soit 2 mois après le début de la crise dans l’est libyen, que la CPI a entamé une procédure contre Kadhafi et son fils Saïf Al-Islam : les bombardements qui n’ont pas cessé depuis 8 mois et qui ont fait plusieurs milliers de victimes civiles (il y en avait déjà 1.000 à la fin mai) ont très vite perdu leur caractère militaire, pour devenir essentiellement politique : abattre le régime de la Jamahiriya et si possible procéder à l’élimination physique de Kadhafi et de ses proches par des tirs ciblés, ce qui a été réalisé à Syrte le 20 octobre à la suite d’une opération de l’aviation française [17].
C’est ainsi que de nombreux bâtiments publics, sans le moindre intérêt stratégique (notamment à Tripoli et les villes pétrolières Ras Lanouf, Brega, Ajdabiya) ont été bombardés [18]. Ont été aussi bombardés des réseaux de communication, des éléments de l’infrastructure industrielle, des monuments historiques, etc.
L’ensemble de ces actes constitue des crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité, relevant de la compétence de la justice pénale internationale.
Quant aux opérations « ciblées » (que l’armée israélienne pratique souvent à l’encontre de cadres palestiniens) visant à assassiner des proches de M. Kadhafi (plusieurs de ses enfants ont été tués) et M. Kadhafi lui-même (par exemple, le bombardement du domicile privé de l’un des fils de Kadhafi, provoquant le mort de deux de ses petits enfants), elles ne peuvent s’inscrire dans une opération de paix et de « protection » sous le drapeau de l’ONU ! Si M. Kadhafi avait pu être déféré devant la CPI [19], les responsables des bombardements et des tentatives de meurtres par l’armée française visant des dirigeants d’un État membre des Nations Unies, quelles que soient les infractions qu’ils aient pu commettre, sont passibles eux aussi des sanctions prévues par le droit pénal international ! C’est particulièrement flagrant avec l’assassinat de M. Kadhafi lui-même, avec la collaboration active de l’OTAN et de l’aviation française.
La Résolution 1674 du Conseil de Sécurité du 28 avril 2006 rappelle que « le fait de prendre délibérément pour cible des civils (…) en période de conflit armé constitue une violation flagrante du droit international humanitaire ». Les tirs ciblés sont d’une nature particulièrement criminelle : l’ONU n’a pas pour fonction de faire exécuter des peines de mort !
On peut aussi noter, parmi les illégalités flagrantes, les procédures suivies en matière de gel des avoirs libyens publics et privés. En effet, les mesures prises durant la guerre de Libye ne tiennent pas compte des résolutions 1452 (2002) et 1735 (2006) du Conseil de Sécurité. Les transferts réalisés par la France et ses alliés européens au bénéfice du CNT n’ont pas non plus respecté la réglementation européenne.
En fait, l’approche juridique occidentale sur la Libye rejoint les positions de G. Scelle dans son manuel de 1943 sur la « Russie bolchévique ». Selon cet auteur classique, ce régime « aurait dû être considéré comme internationalement illégal » [20]. La « Russie bolchévique » n’aurait pas dû être admise comme sujet de droit. Elle ne l’a d’ailleurs été que partiellement jusqu’en 1945.
Plus d’un demi-siècle plus tard, les atteintes à la légalité par les États occidentaux en Libye n’en sont pas, car il s’agit de détruire un régime détestable, « illégal » par nature !
Ainsi, ce ne sont pas seulement certains peuples, comme le Peuple palestinien, qui se voient refuser la qualité de sujet à part entière du droit international, certains États pourtant membres des Nations Unies n’ont pas non plus « droit au droit ».
Le principe qui semble découler de cette pratique occidentale, c’est que ce ne sont plus les États qui ont droit au droit international, ce sont les régimes bénéficiant de l’aval des puissances occidentales.
2. Continuité et imperturbabilité des juristes
En tant que juriste, la première observation qui s’impose est le silence assourdissant des internationalistes, de la même nature que celui qui a pour le moins hypothéqué la scientificité de leurs jugements pour l’Irak, le Kosovo [21], l’Afghanistan ou la Côte d’Ivoire, par exemples. La doctrine dominante chez les internationalistes demeure « impassible » : les manuels les plus récents ne témoignent d’aucune inquiétude, bien qu’ils évitent d’illustrer leurs propos académiques d’exemples non exemplaires !
Pour nombre d’entre eux, les doctes professeurs de droit international, se sont fait ultra-cicéroniens : « Summum jus, summa injuria » ! Pour Cicéron, en effet, un « excès » de droit amène les pires injustices. Alignés derrière le personnel politique majoritaire en Occident, les juristes considèrent que le droit international lorsqu’il limite par trop le « messianisme », y compris guerrier, des États-Unis, de la France, de la Grande Bretagne, devient destructeur des valeurs civilisatrices dont il est porteur. L’idéologie, qu’ils récusent formellement pour eux-mêmes, est omniprésente dans leurs analyses : la « légitimité » prend le pas sur la « légalité », ce qui, pour les juristes, peut paraître surprenant !
En réalité, ils admettent implicitement que les États occidentaux s’auto-régulent dans l’intérêt du Bien Commun. Il ne s’agit pas d’un mépris de la légalité chez ceux qui se réclament hautement de « l’État de droit » : pour ces juristes, les puissances occidentales se situent « au-dessus » d’un « juridisme inadapté » au nom de la « mission » supérieure qu’ils se doivent d’accomplir sans entraves. Étant donné l’inconvenance qu’il y a à mettre en cause la politique étrangère des États-Unis et leur conception anti-multilatéraliste, on ne saurait faire non plus le procès des autorités françaises lorsqu’elles justifient (depuis le « Bettato-Kouchnérisme » qui a fait florès) leurs ingérences au détriment de la souveraineté des petits et moyens États au nom des droits de l’homme.
Le Président Sarkozy a poussé très loin le « Bettatisme », en 2010-2011, lorsqu’il a étendu le champ de l’ingérence au contentieux électoral (c’était une première !) : la France s’est même faite, aux côtés des États-Unis et de l’ONU, juge constitutionnel en lieu et place de l’instance ivoirienne compétente pour user en définitive de la force armée afin de changer le régime d’Abidjan, y compris au prix d’une tentative d’assassinat du Président L. Gbagbo [22].
La crise libyenne est allée encore au-delà : elle a permis de consacrer la notion de « révolution démocratique » parmi les causes légitimant la mise à l’écart de la légalité internationale. Les juristes rétablissent ainsi la vieille conception qui distinguait jusqu’au milieu du XX° siècle (voir les démonstrations du professeur Le Fur, par exemple, dans les années 1930-1940) les sujets relevant du droit international et ceux inéligibles à ce même droit, créant ainsi les conditions d’une nouvelle hégémonie impériale occidentale. Néanmoins, la distance pouvant séparer la pensée juridique dominante et les positions politico-médiatiques officielles tendant à disparaître, le droit international des manuels et des revues académiques demeure un long fleuve tranquille, à l’image des pages de Wikipédia qui lui sont consacrées [23]. Les éminents auteurs se consacrent aux problèmes techniques de l’Union Européenne, « planète » plus politiquement sérieuse, tandis que d’autres, tout aussi éminents, notent « la résistance des souverainetés devant les progrès du droit international » (!), progrès jugés « incontestables et importants » lors de ces dernières décennies !!
La nouvelle multipolarité, en gestation, n’est guère appréciée : la Chine (souvent qualifiée d’ « arrogante ») comme la Russie se voient reprocher l’exercice du droit de veto au Conseil de Sécurité, car le « risque est celui du désordre, de l’incapacité, de l’insuffisance d’organisation ». La brève configuration unipolaire qui a succédé à la fin de l’URSS était beaucoup plus appréciée : devait enfin se réaliser grâce à l’unipolarité occidentaliste – que l’on ne savait pas très temporaire – le règne effectif du droit international, la puissance assurant la « bonne gouvernance », par dédoublement fonctionnel, étant évidemment les États-Unis et accessoirement leurs alliés, dotés d’une « vision » universaliste [24].
En tout état de cause, le juriste occidental représentatif est celui qui n’apprécie pas le principe de souveraineté qui reste pourtant au cœur de la Charte des Nations Unies, d’autant plus que la puissance dont il relève est souveraine de facto.
Le terme de « violation » de la légalité ne vient qu’exceptionnellement sous sa plume, encore moins celui de régression. Il n’y a qu’ « interprétations », « ajustements » ayant pour fin de satisfaire toujours mieux les intérêts de l’Humanité toute entière [25].
Le juriste académique préfère s’attarder sur les « nouveaux acteurs » de la « communauté » internationale, tels les ONG et l’ « individu » [26], en voie de donner naissance à la « société civile » internationale… L’intervention militaire en Libye ne s’est-elle pas fondée (résolution 1970 et 1973 du Conseil de Sécurité) sur la protection de cet individu « civil » menacé par un pouvoir détestable, tout comme les États européens agissaient déjà au XIX° siècle contre l’Empire Ottoman par des « interventions d’humanité », les thèses du Saint-Siège précédant celles des Bush, Kouchner et autres Sarkozy !
Le juriste britannique H. Wheaton justifiait dans le même esprit l’intervention anglaise au Portugal en 1825, jugée conforme « aux principes de la foi politique et de l’honneur national ». De même, ajoutait-il, est fondée « l’intervention des puissances chrétiennes de l’Europe en faveur des Grecs ». Un siècle plus tard, en 1920, le Doyen Moye de l’université de Montpellier, affirmait sans réserve qu’ « on ne saurait nier les bienfaits indiscutables que l’immixtion a plusieurs fois amenés (…) Il est très beau de proclamer le respect de la souveraineté même barbare et de déclarer qu’un peuple a le droit d’être aussi sauvage que bon lui semble. Il n’est pas moins vrai que le christianisme et l’ordre sont des sources de progrès pour l’humanité et que bien des nations ont bénéficié à voir leurs chefs, inaptes ou tyranniques, obligés de changer leurs méthodes sous la pression des puissances européennes. La persuasion ne réussit pas toujours à elle seule et il faut parfois faire le bien des gens malgré eux…. » [27].
Qui ne reconnaît, à peu de choses près, l’analyse faite un siècle plus tard par les instances américaines, françaises, britanniques et onusiennes contre Kadhafi et autres Gbagbo ?
Seuls ceux qui, aujourd’hui encore, condamnent les expéditions coloniales au nom d’une culpabilité « infondée », alors qu’il s’agissait selon la doctrine de combattre la « barbarie des peuples sauvages, occupant sans titre des territoires sans maître », ne perçoivent pas la signification civilisationnelle et humaniste des interventions occidentales et l’éventuelle nécessité de mettre en place des néo-protectorats, y compris sur les petits Etats occidentaux « mal gouvernés » !
Le Fur, éminent titulaire de la chaire de droit international de la Faculté de Droit de Paris, auteur du précis Dalloz 1931 et de divers manuels entre 1930 et 1945, accompagné d’autres professeurs comme Bonfils, Fauchille, etc. insistait sur le thème de la Civilisation combattant la Barbarie : « il y a incompatibilité d’humeur entre nous et l’arabe » car « le mot d’ordre de l’arabe est : immobilité ; la nôtre est en avant ! » (sic) [28]. Le Fur ajoute, à propos de la colonisation, que « la France n’a pas travaillé seulement dans son intérêt, mais pour le bien commun de l’humanité ».
Pour les juristes de cour contemporains, les États occidentaux, soucieux par nature du Bien et de l’intérêt général, entendent aujourd’hui comme hier protéger par tous les moyens l’individu et les populations civiles contre les menées de leur propre État. Or, le libyen kadhafiste est pire que l’arabe d’hier : à son encontre, la guerre est « juste ». Rien ne change depuis un auteur du XIX° siècle comme H. Wheaton, qui affirmait, comme on le fait aujourd’hui que « lorsqu’il y a atteinte portée aux bases sur lesquelles reposent l’ordre et le droit de l’humanité » le recours à la force est fondé. D’ailleurs, l’Institut de droit international au début du siècle ne partage pas « l’utopie de ceux qui veulent la paix à tout prix ». G. Scelle, dans son manuel édité en 1943 à Paris, y met du sien lorsqu’il affirme que lorsqu’un État possède « un titre authentique et probatoire » à faire valoir, « la prohibition du recours aux armes semble difficile à admettre ». Aujourd’hui, peu importe l’élément nouveau que constituent les principes de la Charte des Nations Unies ! La France n’a-t-elle pas souligné pour justifier son rôle déterminant dans l’opération anti-Tripoli qu’elle possédait tous les titres pour intervenir, c’est-à-dire ceux fournis par les Nations Unies, fondés sur les droits de l’homme et ceux de l’OTAN pour sauver les Libyens d’eux-mêmes !
D’ailleurs, de manière consensuelle, dans la doctrine juridique classique (Gidel, La Pradelle, Le Fur, Sibert, Verdross, etc.), le respect de la propriété est considéré comme le principe fondamental des relations internationales pour le monde civilisé. Pour M. Sibert, c’est même « une vérité hors de discussion ». Or, chacun sait en 2011 l’emprise du régime kadhafiste sur le pétrole libyen qui n’était jusque-là, pour le reste du monde, qu’une ressource aléatoire : aujourd’hui, comme hier, la liberté des échanges « interdit » le manque à gagner que représente l’accaparement tripolitain.
C’est par exception que des professeurs comme Carlo Santulli ou P.M. Martin, par exemples, prennent une position forte contre la violation de la légalité dans l’affaire libyenne ou la question n’est pas de « défendre le régime » dans l’opinion publique, « mais simplement de ne pas transformer l’analyse critique en une propagande monstrueuse ». En Libye, comme en Côte d’Ivoire, le monde occidental et l’Etat français en premier lieu ont fait chorus pour déshumaniser « l’ennemi » (qu’il s’agisse de L. Gbagbo ou de M. Kadhafi), en dépit des contrats conclus sous leur patronage avec les milieux d’affaires : « le sang des Libyens (comme celui des Africains ne vaut rien pour nous », constate le professeur C. Santulli.
Le juriste et le politicien de droite ou d’une certaine « gauche » se retrouvent sur les mêmes positions. La « morale » doit l’emporter sur le « juridisme étroit », comme a pu le déclarer dans la presse ivoirienne l’Ambassadeur des États-Unis à l’encontre du Président Gbagbo [29]. Pour le juriste, le positivisme doit lui-même céder la place au descriptivisme et au réalisme. Le débat n’est plus de mise. Comme l’affirme R. de Lacharrière « Il faut s’habituer à l’idée que les controverses doctrinales appartiennent au passé » !
Or, la description non critique et complaisante des politiques étrangères par les juristes s’identifie à leur légitimation sans réserve. La doctrine dite « savante », très occidentalo-centriste, est très proche des grands médias. Le « droitdel’hommisme » et le « sécuritarisme » dont les puissances occidentales se font les championnes et qui défont l’ensemble du droit international édifié depuis 1945 [30] conduisent en fait les juristes à se rallier au dédoublement fonctionnel autoproclamé de l’OTAN et de ses membres porteurs de valeurs euraméricaines et « civilisatrices » ! On n’est pas très au clair sur le « droit » ou le « devoir » d’ingérence, mais le principe onusien de la non-ingérence est balayé. Il y a bien quelques flottements sur le principe de la souveraineté (rappelé par précaution dans toutes les résolutions du Conseil de Sécurité, y compris celles qui le violent), mais la « légitimité démocratique », dont la définition est incertaine, doit l’emporter. Pas question de s’interroger sur la mise en œuvre de néo-protectorats, puisqu’il n’y a officiellement qu’une assistance à la « transition démocratique ».
Avec les mouvements populaires de 2011, dans le monde arabe, les internationalistes vont jusqu’à faire leur la « révolution » (honnie et jugée archaïque par ailleurs) [31] elle-même en tant que productrice de démocratie.
Si l’on peut admettre que la tâche des juristes n’est pas de désigner le souhaitable, peut-être est-elle tout de même de mettre en procès les processus de régression et de se manifester en tant que « veilleurs critiques ».
3. L’expédition franco-britannique : l’affirmation d’une politique impériale en état d’urgence
L’expédition franco-britannique et autres en Libye s’inscrit dans la tradition impériale des grandes puissances occidentales. Le sarkozisme s’efforce de créer l’illusion d’un retour à la « grandeur » de la France et de l’Europe. Mais, comme à l’époque coloniales, le pétrole, d’une qualité exceptionnelle et d’extraction facile ainsi que le gaz libyens, représentent l’enjeu essentiel du changement de régime à Tripoli. Les accords franco-libyens, italo-libyens et américano-libyens des dernières années étaient considérés comme peu fiables. Paris et Londres de plus estimaient nécessaire un nouveau partage, n’ayant pas obtenu les meilleures concessions. De plus, de nombreux projets libyens en gestation projetaient de porter la participation de l’État dans le secteur pétrolier de 30 à 51% ; il était aussi envisagé de remplacer les firmes occidentales par des sociétés chinoises, russes et indiennes. Après une phase de compromis, Tripoli se préparait à mettre en œuvre une nouvelle politique [32].
L’intervention française n’est pas étrangère non plus à certains problèmes franco-français. Les élections présidentielles approchant et, à l’image de Bush aux États-Unis, le président sortant, en difficulté dans l’opinion française, a estimé qu’une rapide et brillante politique extérieure en Libye (ce qui semble être attesté par les exigences d’un calendrier très bref exprimées à plusieurs reprises) compenserait les échecs de politique intérieure. La crise provoquée par les liens étroits longtemps maintenus avec le régime de Ben Ali et celui de Moubarak devait aussi être effacée.
La révélation lancée depuis Tripoli que la campagne électorale de 2007 de N. Sarkozy avait été financée par des « mallettes » libyennes a sans doute accéléré le processus de l’engagement militaire de la France.
De plus, depuis longtemps, les États-Unis ont souhaité que les États européens prennent le relais des dépenses militaires occidentales, en particulier pour « protéger » l’Afrique des alternatives offertes par la Chine et les puissances émergentes à chaque État africain. Le rôle primordial joué par la France en Libye entre donc parfaitement dans les vues des États-Unis. D’autre part, les États-Unis ont l’ambition d’installer en Libye, dans le Golfe de Syrte, le commandement unifié (« Africom ») actuellement basé à Stuttgart et que tous les pays africains ont jusqu’à ce jour refusé. La mise sous tutelle de la Libye permettra l’installation de ce commandement, 42 ans après l’expulsion des bases américaines de Libye par la révolution kadhafiste.
L’un des objectifs de l’opération de liquidation du régime de Tripoli, passé sous silence, est aussi la volonté de sécuriser Israël. Israël a besoin d’États arabes acceptant de refuser leur solidarité avec les Palestiniens, comme l’a fait avec efficacité l’Égypte de Moubarak. Les mouvements populaires en Tunisie et en Égypte démontrent une instabilité dangereuse. Cette incertitude doit être compensée par la disparition d’un régime libyen radicalement anti-sioniste.
La France est aussi particulièrement préoccupée des tentatives kadhafistes d’union des Africains. Les flottements de l’Union Africaine lors de la crise ivoirienne ont montré que l’organisation africaine est traversée de contradictions et que l’influence française s’est réduite. L’influence de Kadhafi et les moyens financiers dont il disposait rivalisaient fortement avec ceux de la France. L’élimination du leader libyen (de nombreuses opérations françaises ont été montées depuis 1975 contre lui [33]) est donc considérée comme le moyen de protéger les intérêts français en Afrique en cassant la Libye en train de devenir le financier alternatif du continent [34].
Cette guerre en Libye survenant après l’intervention en Côte d’Ivoire, et après les multiples opérations menées au Moyen Orient, a une signification générale.
Les pays occidentaux sont en état d’urgence. Incapables de résoudre les contradictions majeures internes de nature économique et financière, ils sont conduits à développer une politique étrangère agressive en dépit de son coût élevé, à la fois pour récupérer, si possible, les ressources qui viennent à leur manquer et pour faire diversion devant leur opinion publique.
L’urgence résulte aussi de l’arrivée des puissances émergentes qui bousculent les intérêts occidentaux, sans imposer de clauses de conditionnalité politique dans les contrats et accords qu’elles concluent. L’Occident semble considérer que « demain, il sera trop tard ».
Cette politique d’urgence obéit à un « modèle » standard dont les étapes sont de plus en plus brèves.
L’intervention militaire n’est que la dernière étape de l’ingérence : la première est une opération de discrédit systématique du régime à éliminer.
La seconde étape est la sensibilisation et la mobilisation de la diaspora, en particulier par le relai des « nouveaux médias » [35] : les bi-nationaux de Libye mais vivant en Europe ou aux États-Unis ont, semble-t-il, joué un rôle déterminant contre Tripoli, aidant à une mobilisation de certaines factions de la population, notamment une jeunesse sans mémoire politique [36] en rupture avec un pouvoir politique jugé « usé » [37].
La troisième étape est la recherche d’appuis internationaux. La France, en pointe dans l’affaire libyenne, s’est efforcée de constituer une coalition non seulement avec des alliés occidentaux traditionnels (y compris l’Italie [38], qui avait pourtant établi des liens très étroits avec Tripoli dans la période précédant immédiatement l’intervention armée) mais avec des États du Sud pour bénéficier de leur « caution ». La participation du Qatar, des Émirats Arabes, l’appui de l’Arabie Saoudite (principal fournisseur de pétrole de la Chine !) a été essentielle pour légitimer l’intervention militaire et lui retirer (formellement) son aspect néo colonial.
La quatrième étape est l’obtention de la couverture onusienne. Les États-Unis savent se passer aisément de la caution du Conseil de Sécurité ; les Européens, la France en particulier, s’efforcent au contraire de rester dans le cadre des procédures des Nations Unies, tout en violant sans scrupule l’esprit et souvent les dispositions fondamentales des résolutions du Conseil de Sécurité et de la Charte elle-même.
Enfin, et c’est la cinquième étape, l’opération militaire se développe jusqu’à son terme, avec le consentement d’une opinion préfabriquée. Cette dernière étape démontre que le Conseil de Sécurité n’est plus qu’un instrument d’ingérence et de guerre (sauf s’il est bloqué par l’exercice aléatoire du droit de veto de la Chine et de la Russie, dont les priorités ne sont pas encore politiques mais essentiellement économiques). Elle atteste d’un déclin global des Nations Unies, comme structure de conciliation et de maintien de la paix, pouvant préluder à une mort comme l’a connue la SdN. Le Chapitre VII de la Charte permet à l’occasion de tout conflit interne d’un pays que les puissances veulent sanctionner de liquider son régime. Les droits de l’homme et la « légitimité démocratique » ne sont qu’un argument légitimant la violence armée. Les « populations civiles », dont nul ne vérifie par une procédure contradictoire, ce qu’elles sont réellement, en particulier si elles sont armées ou pas (et par qui), deviennent un véritable sujet de droit, source de l’ingérence [39].
Enfin, la pseudo-morale qui est produite pour justifier cette politique relève du primitivisme le plus basique et de la plus grande vulgarité idéologique (distinction du Bien et du Mal, de la Démocratie et de la Dictature, etc.). Logiquement, elle intègre la violence « juste » contre « l’ennemi » et va jusqu’à admettre le meurtre, moyen parmi d’autres, d’éliminer un dirigeant que l’on conteste [40].
Durant la guerre de Libye, les bombardements français, en usant de la formule « destruction des centres de commandement », ont visé à de nombreuses reprises les proches de M. Kadhafi (tuant plusieurs de ses enfants et petits enfants) et Kadhafi lui-même. Ces assassinats politiques témoignent de la volonté française de n’admettre aucune négociation ni aucune conciliation, sans susciter de réaction des Nations Unies.
Quelles que soient les spécificités de l’affaire libyenne, il ne s’agit pas d’un cas sui generis.
La signification est générale : la crise globale qui affecte l’économie mondiale sous hégémonie occidentale provoque une fuite en avant et peut donner lieu à d’autres opérations de même nature contre divers « ennemis » déjà désignés, si les tentatives de déstabilisation interne mais « assistées » de l’extérieur échouent.
Les contradictions du système imposent dans l’urgence une logique qui n’est pas celle de la coexistence de régimes différents et du respect de la souveraineté de chacun.
Pour les peuples concernés, c’est à nouveau la disparition de la souveraineté nationales et de l’indépendance au nom d’une « modernité » de type impérial et le maintien d’une souveraineté « populaire » formelle ; c’est l’accumulation d’un retard de développement dû aux destructions et à la désorganisation ; c’est la corruption affairiste qui succèdera aux accaparements claniques.
En dépit de l’inertie idéologique de la plupart des juristes et de nombreux politistes dont le ronronnement théorique ne se dément pas, on peut constater sans tomber dans l’excessif, l’état comateux du droit international, la faillite de l’ONU et la résurgence d’une « morale » internationale douteuse en lieu et place de la régulation juridique, proche de celle du XIX° siècle, temps béni de la canonnière ? Le modèle implicite des diplomaties occidentales ne serait-il pas une nouvelle Conférence de Berlin, 128 ans après la première !
La guerre de Libye n’est-elle pas un symptôme parmi d’autres d’une processus de dé-civilisation ?
Cette intervention de Robert Charvin a été prononcée lors de la journée d’études “Les régimes arabes dans la tourmente : la révolution entre communication et réactions internationales” organisée par l’Université de Toulouse 1 Capitole le 4 novembre 2011. Robert Charvin est juriste international, doyen honoraire de la faculté de droit de Nice.
( Par Robert Charvin, juriste, doyen honoraire de la faculté de droit de Nice )
Notes
[1] Y. Quiniou. Retour sur la guerre néo-coloniale à laquelle nous avons assisté . L’Humanité. 24 octobre 2011.
[2] Cf. R. Dumas – J. Vergès. Sarkozy sous BHL. Éditions P.G. De Roux. 2011.
[3] Voir P.M. Martin, qui, dès 2002, publie Défaire le droit international : une politique américaine. UTI Sciences Sociales de Toulouse, n° 3, 2002, p. 83 et s. En 2011, les autorités françaises sont « en pointe » dans cette volonté de « défaire » le droit international.
[4] Cf. R. Charvin. Côte d’Ivoire 2011. La bataille de la seconde indépendance. L’Harmattan. 2011.
[5] Voir le Rapport établi par la Commission de Juristes dont l’auteur a fait partie, ce qui l’a conduit à être soumis par les nouvelles autorités présidées par A. Ouattara à un « gel de ses avoirs » en Côte d’Ivoire !
[6] Les autorités françaises, comme les grands médias, ont assimilé les événements de la Tunisie, de l’Égypte et de la Libye en fabriquant une « morale » à la convenance des intérêts français pour fonder une opération militaire contre le régime de Kadhafi. Le seul point commun entre ces événements est que les trois régimes ont été intensément courtisés par l’État français peu de temps avant qu’ils aient été « condamnés ».
[7] L’évolution d’Al-Jazeera qui s’est imposée en 15 ans dans le monde arabe comme une source originale d’information, s’est soudainement engagée dans une vaste campagne hostile aux régimes libyen et syrien. Cette modification pro-occidentale de la ligne éditoriale de 2011 – qui a entraîné la démission de certains journalistes -, consécutive à l’appel à une intervention armée du Conseil de Coopération du Golfe et du Qatar, n’est pas encore parfaitement claire. La journaliste Marie Bénilde (Le Monde Diplomatique, n° 117, juin-juillet 2011), sans chercher plus loin, considère qu’Al-Jazeera et le web « ont semé la parole démocratique au vent de l’histoire » ! (Cf. Quand la liberté a le parfum du jasmin. op. cit. p. 49 et s.).
[8] C’est la même précipitation que la France a manifesté en reconnaissant le CNT bien avant que celui-ci ait une responsabilité quelconque et un contrôle effectif d’une partie conséquente du territoire libyen.
[9] Le cas limite est celui de la question israélo-palestinienne que le Conseil de Sécurité, malgré les multiples résolutions de l’Assemblée Générale, s’avère incapable de faire progresser depuis plus d’un demi-siècle.
[10] C’est ainsi que dans les villes de Tripoli, Syrte et Shebba aucune opposition ouverte ne s’est manifestée entraînant une forte répression des civils : ces villes ont néanmoins été intensément bombardées.
[11] On a pu noter qu’à Bahreïn, l’armée saoudienne est intervenue pour réprimer la révolution populaire et sauver le régime avec la pleine approbation occidentale.
[12] On peut noter, simplement, l’information – quasi admirative – fournie par les médias français concernant le statut de la femme en Arabie Saoudite avec l’amnistie d’une Saoudienne qui avait enfreint l’interdiction de conduire une automobile et l’annonce qu’en 2015, pour les élections municipales les femmes auraient le droit de vote !
[13] Le double jeu de la France est partout : elle a voté pour l’adhésion de la Palestine à l’UNESCO pour ensuite refuser son admission à l’ONU dans le cadre du Conseil de Sécurité.
[14] Cf. Quand la liberté a le parfum du jasmin. op. cit. p. 32.
[15] Le professeur Géraud de la Pradelle dénonce le comportement de certains juristes occidentaux qui expliquent aux états majors des armées et parfois aux officiers engagés sur le terrain comment contourner les « obstacles » dressés par le droit humanitaire qui contrarie les pratiques militaires « efficaces ». Cf. « Des faiblesses du droit international humanitaire qui tiennent à sa nature ». In Droit humanitaire. États puissants et mouvements de résistance, sous la dir. D. Lagot. L’Harmattan. 2010, p. 33 et s.
[16] Les médias français (notamment télévisuels) ont été d’une particulière nullité et d’une profonde mauvaise foi, conjuguant mensonges multiples sur les événements liés au conflit et silence sur la personnalité des membres du CNT (Mohamed Jibril, par exemple, ex-ministre de Kadhafi avait antérieurement tissé des liens avec B-H Lévy, en créant des sociétés de négoce dont l’une chargée du commerce des bois de Malaisie et d’Australie avec son ami français). La presse occidentale (à l’exception de l’Humanité pour la France) et les ONG humanitaires (sauf le MRAP) ont été notamment d’une totale « discrétion » sur les massacres racistes et xénophobes subis par les noirs qu’ils soient libyens ou émigrés d’Afrique noire. Par ailleurs, plusieurs centaines de milliers de Libyens (le chiffre semble être proche des 400.000) ont quitté le territoire national pour les pays voisins, en particulier la Tunisie. Divers hôpitaux ont été détruits par les bombardements de l’OTAN, par exemple, récemment, l’hôpital Avicène de Syrte, sans soulever les condamnations pourtant habituelles des organisations humanitaires.
[17] L’exécution de M. Kadhafi était une exigence politique, un procès devant la CPI était jugé par les autorités françaises et américaines comme « dangereux ». Pour le Centre de planification et de conduite des opérations (CFPO) à la direction du Renseignement Militaire et au Service Action de la DGSE, il s’est agi de porter assistance aux unités du CNT à Syrte afin de « traiter le Guide libyen et les membres de sa famille », autrement dit les éliminer.
[18] Par exemple, à Tripoli, la Cour des Comptes, le Centre anti-corruption, le Tribunal Supérieur, des hôpitaux, un marché, le siège de différentes associations (dont l’association d’aide aux handicapés, du mouvement des femmes, etc.).
[19] L’Union Africaine a dès les 29-30 juin 2011 déclaré que les mandats d’arrêt lancés par la CPI contre Kadhafi et ses proches ne devaient pas être appliqués sur le territoire africain. Jean Ping, Secrétaire Général de l’U.A a vivement critiqué Luis Moreno Ocampo, Procureur près la CPI, le qualifiant de « plaisantin » et l’invitant à dire le droit au lieu de suivre la politique occidentale.
[20] Cité par R. Charvin. Le droit international tel qu’il a été enseigné , in Mélanges Chaumont. Pédone. 1984, p. 138.
[21] Le professeur Guilhaudis, par exemple, dans son manuel de Relations internationales contemporaines, Litec. 2002, ose intituler un paragraphe « L’interminable éclatement violent de la Yougoslavie, malgré l’ONU et l’OTAN » ! (p. 730).
[22] Une procédure a d’ailleurs été ouverte en France contre l’armée française pour « tentative de meurtre de L. Gbagbo ». L’arrestation du Président ivoirien s’est en effet produite par la collaboration des forces françaises et ivoiriennes, après un intense bombardement par la force de La Licorne de la résidence de L. Gbagbo.
[23] Cf. R. Charvin. De le prudence doctrinale face aux nouveaux rapports internationaux . In Mélanges Touscoz. France Europe Éditions. 2007.
[24] L’Empire Ottoman, la monarchie absolue de François Ier ou de l’Espagne avaient déjà la même ambition !
[25] Lorsque les États-Unis et le Conseil de Sécurité, au mépris des dispositions de la Charte, décident en 1950, en l’absence de l’un des membres permanents, d’intervenir militairement en Corée, le professeur Sibert, dans la tradition académique, porte un jugement positif sur « l’interprétation libérale » et non « rigide » de la Charte.
[26] Étrangement, les juristes académiques associent dans leurs enseignements ces deux catégories « d’acteurs » précités aux firmes transnationales, comme si leur poids respectif dans la société internationale était équivalent ! Par contre, le silence règne encore sur les sociétés militaires privées qui prétendent favoriser la sécurité collective, en Irak, par exemple.
[27] Doyen Moye. Le droit des gens moderne. Sirey. 1920, p. 219-220.
[28] Cf. Le droit international tel qu’il a été enseigné. Notes critiques de lecture des traités et manuels (1850-1950) , in Mélanges Chaumont. Pédone. 1994.
[29] R. Charvin. Côte d’Ivoire 2011. La bataille de la seconde indépendance. L’Harmattan. 2011.
[30] P.M. Martin. Défaire le droit international : une politique américaine. Droit écrit. UTI Sciences Sociales de Toulouse, n° 3. 2002, p. 83 et s.
[31] Il faut constater aussi que la « révolution » a été admise comme un concept parfaitement valide pour certaines ex-républiques soviétiques (Ukraine, Géorgie, etc.).
[32] On peut comparer cette réorientation à celle du Président Gbagbo qui, à la veille de son renversement par les Occidentaux s’apprêtait à quitter le franc-CFA et à conclure des contrats économiques d’importance avec la Chine.
[33] Dans le catalogue des tentatives d’élimination de M. Kadhafi, on peut relever l’opération initiée par le Président Giscard d’Estaing en 1975 (SDEC + quelques militaires dissidents), les commandos franco-égyptiens (au temps de Saadate en 1977), un attentat en 1979 du Service Action où Kadhafi est blessé, en 1980, le SDC et des Égyptiens échouent à nouveau (entraînant le limogeage de de Marenches), en 1980 encore, une tentative (révélée par le Président Cossiga) d’abattre l’avion officiel de Kadhafi se rendant à Varsovie avec l’aide de l’OTAN, en 1984 une tentative appuyée par les États-Unis de coup d’état, avec l’aide d’exilés et de militaires, en 1986 le bombardement de la résidence de Kadhafi.
[34] Depuis les premiers pas de la Révolution libyenne, le monde occidental n’a jamais pardonné à Tripoli d’user des mêmes moyens que ceux de l’Occident pour faire avancer sa politique étrangère.
[35] De nombreux politistes insistent sur le rôle politique des nouveaux modes de communication dans les « révolutions » du Sud. Cette analyse néglige le fait qu’une large partie de la population, souvent majoritaire et particulièrement démunie, les ignore. On peut faire l’hypothèse qu’une fois de plus dans l’histoire, la mise en exergue des « outils » évite de prendre en compte les réalités sociales profondes. Nombre de politistes, de plus, se félicitent implicitement du rôle des « classes moyennes » – pourtant toujours indéfini et politiquement surestimé – par rejet souvent explicite des classes populaires.
[36] Le régime de M. Kadhafi avait 42 ans. La jeunesse majoritaire dans la population libyenne ignore tout de la Monarchie du Roi Idriss, régnant sur l’un des pays les plus pauvres du monde, et avait soif d’une normalité plus facile à vivre que la Révolution Jamahiriyenne, même après ses compromis des années 2002, en dépit du fait que la Libye ait le plus haut niveau de vie d’Afrique.
[37] Dans les pays occidentaux, on constate le même phénomène, mais il n’est pas poussé jusqu’à son paroxysme par des stimulants externes.
[38] Tripoli, avec la collaboration de diverses personnalités internationales, attribuait régulièrement un « Prix Kadhafi des droits de l’homme et des Peuples ». Ce prix, le premier émanant d’un pays du Sud, dont l’esprit était de ne pas laisser le monopole de la question des droits de l’homme aux puissances occidentales, a été qualifié du nom de Kadhafi, non par les Libyens eux-mêmes, mais à l’initiative d’un Français, présent à Tripoli, à l’issue d’une conférence internationale, qui était à l’origine Secrétaire Général de la Fédération des Villes Jumelées. Le premier prix décerné l’a été à N. Mandela, à l’époque encore emprisonné. Le dernier prix en 2010 a été accordé à Erdogan (Turquie) pour son action de solidarité avec les Palestiniens, mais Berlusconi a failli en être le bénéficiaire pour, notamment, avoir reconnu la culpabilité coloniale de l’Italie.
[39] Les juristes doivent s’interroger sur la notion de « civils armés » et de leur statut dans un conflit avec les pouvoirs publics, ainsi que sur le problème de circulation illicite des armes par-delà les frontières.
[40] Grotius et Vattel, considérés comme les fondateurs du droit international, ont condamné l’assassinat des dirigeants à l’occasion des conflits entre États.
Source: Al-Oufok