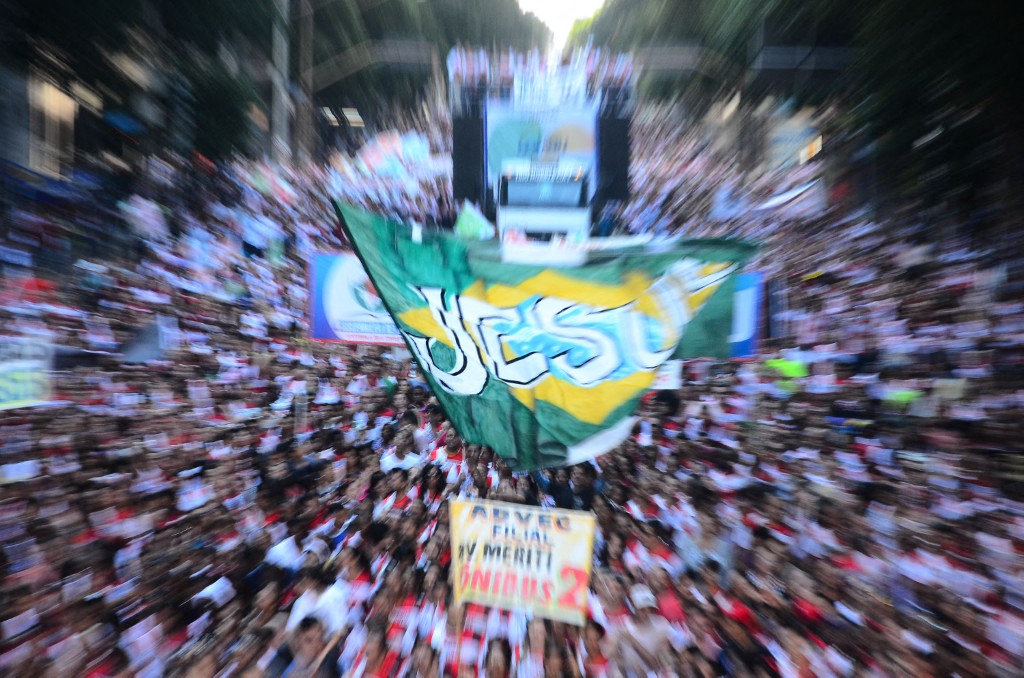L’essor de l’évangélisme au Brésil et en Amérique latine est-il un phénomène purement religieux ? Derrière la façade spirituelle des nouvelles confessions venues du Nord, ne se dissimule-t-il pas une machine d’influence géopolitique pilotée depuis les États-Unis ? Une stratégie de contrôle social, de dépolitisation et d’alignement idéologique au service du grand Hégémon du Nord. Foi, pouvoir et néocolonialisme dans l’arrière-cour.
Tout en posant ces questions, il ne s’agit pas ici de mettre en doute la foi sincère de millions de croyants, ni celle des « messagers de la foi » qui, animés par leur spiritualité, œuvrent pour le bien-être de leurs communautés et leur propre croissance spirituelle. Mais lorsque la foi cesse d’être un refuge pour l’âme et devient une arme politique, lorsqu’elle est instrumentalisée à d’autres fins, lorsque la prière et le sermon servent à des objectifs de manipulation psychosociale, nous sommes alors face à tout autre chose.
L’évangélisme et ses dérivés : le cheval de Troie des États-Unis en Amérique latine
Le Brésil n’est pas seulement le géant de l’Amérique latine par sa taille, sa population ou ses richesses naturelles. Il est surtout le nœud géopolitique qui, historiquement, suscite l’intérêt des États-Unis désireux de maintenir leur influence dans la région. Leur outil le plus efficace de ces dernières décennies ? L’évangélisme conservateur, un mouvement qui, loin d’être spontané ou purement religieux, a été encouragé, financé et dirigé depuis le Nord comme un mécanisme de contrôle social et d’alignement politique.
La relation de Washington avec l’Amérique latine a toujours été marquée par une expression devenue célèbre, reprise sans détour par des figures comme Henry Kissinger, John Kerry ou Marco Rubio : la « cour arrière » des États-Unis. Kissinger, architecte d’une diplomatie interventionniste, ne s’est pas contenté de minimiser l’importance de la région — « il ne s’y passe jamais rien d’important », disait-il —, il a aussi favorisé des coups d’État et des dictatures assurant la soumission au pouvoir américain. Cette même logique perdure aujourd’hui, mais sous des formes plus subtiles : la foi comme arme de pénétration culturelle.
Depuis le début du XXe siècle, et plus fortement encore durant la guerre froide, les États-Unis ont exporté vers l’Amérique latine un modèle d’évangélisme calqué sur celui de leurs méga-corporations religieuses. Des Églises comme l’IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) ou les Assemblées de Dieu n’ont pas seulement importé des doctrines, elles ont aussi adopté une structure organisationnelle pensée pour contrer la progression du catholicisme social, de la théologie de la libération et de tout mouvement populaire remettant en cause le statu quo.
Des agences de renseignement, comme la CIA, ainsi que des groupes de pression idéologiques et cercles de réflexion conservateurs, ont financé ces réseaux et leur expansion. Les temples se sont alors transformés non seulement en plateformes de propagande anticommuniste et pro-capitaliste, mais, plus encore aujourd’hui, en relais directs des intérêts géopolitiques américains, du Mexique à la Patagonie.
De la chaire au Parlement : l’ingérence politique confessionnelle
Une fois consolidée la structure sociale de ces groupes — avec leur réseau de fidèles réunis chaque dimanche, leurs activités de prosélytisme en semaine pour diffuser « la bonne nouvelle » et recruter de nouveaux adeptes, l’étape suivante a consisté en une action politique directe. Rien d’illégitime en soi, si ces initiatives se limitaient à la défense de valeurs morales en harmonie avec une éthique de non-violence envers autrui, d’empathie, de solidarité, de consolation pour les endeuillés, de réflexion sur la finitude de la vie et de quête d’un sens plus élevé, ce que partagent en général les confessions religieuses actuelles.
Mais ces réseaux évangéliques, et d’autres du même type, franchissent la limite lorsqu’ils agissent comme bras électoraux des élites locales ou comme relais d’intérêts étrangers. Depuis la chaire, ou via leurs médias et réseaux sociaux, leurs chefs spirituels ne se limitent plus à prêcher : ils font ouvertement campagne.
Il est aujourd’hui courant de voir des pasteurs promouvoir sans détour des candidats alignés sur Washington ou, inversement, s’opposer frontalement à tout gouvernement défendant la souveraineté nationale ou des politiques progressistes. Cette immixtion, souvent soutenue par des connexions semi-directes avec les agences de renseignement américaines, dépasse le cadre d’un simple lobby légitime : elle constitue une véritable usurpation de la volonté populaire, où la foi devient instrument de manipulation électorale.
Un exemple clair en est la fréquence des prêches qui s’alignent sur les positions de l’évangélisme états-unien (et d’autres confessions implantées en Amérique latine mais issues des États-Unis) en faveur du gouvernement d’Israël. Le conflit israélo-palestinien y est souvent présenté comme une « guerre sainte », blanchissant au passage les actions de l’armée israélienne. S’il ne s’agissait que de reconnaître les racines juives du christianisme ou de chercher une inspiration dans les anciennes Écritures fondatrices du judaïsme, cela serait compréhensible : un culte jeune trouve normalement dans ses origines une source de réflexion et de renouvellement. Mais il n’en est rien : ces prédicateurs agissent comme des agents politiques, non comme des guides spirituels.
Cette posture, qui reproduit à l’identique la politique étrangère des États-Unis et de l’extrême droite israélienne, révèle à quel point le discours religieux est aujourd’hui captif d’une stratégie géopolitique.
Le discours évangélique dominant insiste sur la théologie de la prospérité, la soumission à l’autorité et la moralisation des conflits sociaux. Il se place aussi résolument contre les avancées sociétales du monde contemporain, notamment en matière de droit à l’avortement — garanti comme liberté des femmes de disposer de leur corps et de leur projet de vie — ou encore du droit au divorce.
Mais, au-delà de ces enjeux, cette vaste sphère d’influence ne se limite pas à la géopolitique. Elle s’immisce dans la vie civile, promouvant activement une morale conservatrice fondamentaliste d’inspiration états-unienne, celle-là même qui s’est affichée avec vulgarité dans la vie politique sous l’administration Trump — et dont on peut trouver les racines jusque chez Henry Kissinger. Parmi ses cibles privilégiées : la communauté LGBTIQ+.
Sous couvert d’une rhétorique de « panique morale », ce collectif est présenté comme une menace pour la famille traditionnelle, avec pour objectif de faire reculer ses droits légaux et ses conquêtes sociales. Cette offensive n’a rien de spontané : elle reproduit fidèlement les modèles de la droite religieuse américaine et constitue une diversion efficace, un écran de fumée destiné à masquer les véritables drames structurels de l’Amérique latine — les inégalités économiques et le déficit de souveraineté nationale, deux plaies continuellement entretenues.
Ce n’est pas un phénomène nouveau. Déjà Simón Bolívar, à la fin de sa vie et après l’échec de son rêve d’unité lors du Congrès de Panama, entrevoyait avec lucidité la menace à venir. Dans une lettre prophétique à son ami le colonel Patricio Campbell, il écrivait : « Combien ne s’opposeraient pas à tous les nouveaux États américains, et les États-Unis eux-mêmes, que la Providence semble avoir destinés à couvrir l’Amérique de misères au nom de la Liberté ? » Son intuition s’est tragiquement confirmée. À l’ombre de la doctrine Monroe, le bilan des interventions américaines est écrasant : plus de cent cinquante actions de tous ordres, depuis la création artificielle du Panama pour contrôler le canal, jusqu’aux coups d’État au Chili, au Guatemala ou au Brésil, sans oublier les opérations clandestines et le soutien aux dictatures militaires.
Au XXe siècle, ce modèle de domination s’est perfectionné. Les institutions financières internationales — le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et d’autres agences de développement d’inspiration américaine — ont étendu l’influence du dollar et imposé des politiques qui ont maintenu la région dans un cycle de dépendance, d’inégalités chroniques et d’extractivisme néocolonial. L’endettement extérieur est ainsi devenu un instrument idéal pour manipuler la souveraineté des nations et bloquer tout développement autonome.
Dans ce contexte historique, l’influence exercée à travers les multiples confessions religieuses d’inspiration anglo-saxonne venues du Nord n’est qu’une extension de ce même dispositif. Si les interventions militaires et économiques en sont les griffes visibles, l’évangélisme aligné en est le bras culturel et dissuasif, une arme silencieuse conçue pour conquérir les consciences depuis la chaire, là où la lance ne suffit plus.
Cette prétendue « bataille spirituelle » entre le bien et le mal dissimule ainsi un agenda au service des intérêts de Washington : affaiblir la pensée critique des sociétés latino-américaines et consolider un modèle de soumission idéologique.
Au Brésil, ce phénomène atteint son paroxysme. Des leaders évangéliques proches de figures telles que Donald Trump ou Marco Rubio ont publiquement défendu des positions anti-chinoises, anti-BRICS et anti-PT, reprenant mot pour mot la rhétorique de l’ultradroite américaine. L’élection de Jair Bolsonaro — largement soutenue par des pasteurs entretenant ces « liens transnationaux » — illustre combien l’évangélisme s’est mué en rempart contre les projets souverainistes et multipolaires des nations cherchant leur émancipation. Et ce n’est pas un détail anodin.
Face à cela, la position du président Lula da Silva — « Le Brésil ne veut pas d’empereur », « nous ne sommes l’arrière-cour de personne » — entre en collision directe avec cette machine aussi huilée qu’ancienne. Son pari sur la coopération Sud-Sud, la dédollarisation des échanges et la démocratisation de l’ordre mondial incarne précisément ce que l’évangélisme aligné sur les États-Unis cherche à empêcher : un Brésil souverain, ancré dans les BRICS et maître de son destin.
C’est pourquoi, depuis 2025, l’offensive politique et diplomatique de l’administration Trump à l’égard du Brésil a cessé d’être un simple discours pour se transformer en une série de mesures concrètes et visibles, confirmant que l’évangélisme et la politique étrangère américaine ne sont que deux engrenages d’une même machine d’influence.
En juillet 2025, le président Donald J. Trump envoya à Lula une lettre publique — publiée ostensiblement sur les plateformes officielles de la présidence — dans laquelle il qualifiait le procès intenté contre Jair Bolsonaro de : « a Witch Hunt that should end IMMEDIATELY! ». Autrement dit : « Une persécution politique, une chasse aux sorcières qui doit cesser immédiatement. » En réaction, il lia explicitement cette dénonciation à des mesures commerciales punitives, annonçant l’imposition de droits de douane de 50 % sur les importations brésiliennes (selon une dépêche d’AP News).
Ce geste, mêlant coercition économique et condamnation politique ouverte du système judiciaire brésilien, fut perçu à Brasília comme un « chantage inacceptable » et provoqua une escalade immédiate dans le ton des échanges bilatéraux.
Or, ce que Washington décrivait comme une « chasse aux sorcières » n’était autre qu’un processus judiciaire légitime, fondé sur des faits documentés et de graves atteintes à l’ordre démocratique. Bolsonaro et plusieurs de ses proches collaborateurs furent accusés d’avoir incité et soutenu la tentative de coup d’État du 8 janvier 2023, lorsque des milliers de ses partisans envahirent violemment les sièges des trois pouvoirs : le Palais du Planalto, le Congrès national et la Cour suprême fédérale. Leur objectif : rejeter les résultats du scrutin et provoquer une intervention militaire.
L’enquête, menée par le juge Alexandre de Moraes, établit la diffusion organisée de fausses informations sur un prétendu « fraude électorale », la complicité d’officiers de police et de membres des forces armées, ainsi que l’implication d’anciens ministres dans le financement et la logistique de l’assaut.
En conséquence, la Cour suprême fédérale ouvrit des procédures pour tentative de coup d’État, association criminelle et usage abusif de ressources publiques, remplissant ainsi son devoir constitutionnel : défendre la légalité démocratique contre ceux qui ont tenté de la renverser.
La réaction des États-Unis face à cette action régulière du pouvoir judiciaire brésilien ne se limita pas aux sanctions commerciales. L’administration américaine prit également des mesures ciblées : restrictions de visas et sanctions directes contre plusieurs juges de la Cour suprême du Brésil.
Le secrétaire d’État Marco Rubio, désormais à la tête du Département d’État, annonça la révocation de visas pour plusieurs magistrats, dont Alexandre de Moraes lui-même. Parallèlement, le Trésor américain utilisa des outils de sanctions financières — dans le cadre du E.O. (Global Magnitsky Act) — contre des personnes liées au dossier.
La Maison-Blanche justifia ces décisions en invoquant la défense de la « liberté d’expression » et la lutte contre des « ordres de censure » visant des plateformes américaines. Mais au Brésil, ces mesures furent perçues comme une ingérence flagrante dans l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Ce n’est pas la première fois que des acteurs politiques ou des administrations américaines s’immiscent ouvertement — ou discrètement — dans les affaires latino-américaines. La doctrine Monroe et les innombrables interventions des XIXᵉ et XXᵉ siècles offrent un précédent éloquent.
Plus récemment, à partir de 2020, on a vu se multiplier les soutiens explicites de réseaux trumpistes à des forces politiques brésiliennes proches, tandis que la coopération entre la droite radicale américaine et le camp bolsonariste fut amplement documentée dès 2023 par des médias et des élus du Congrès américain. Cette convergence a préparé le terrain à une alliance transnationale entre extrême droite politique et courants évangéliques alliés.
Les enquêtes et rapports publiés entre 2023 et 2025 mettent en lumière cette continuité entre la pression géoéconomique et l’offensive culturelle et religieuse que cet article s’attache à décrypter.
Mais revenons à l’évangélisme. Ces Églises et réseaux apparentés ne se limitent pas aux sphères du pouvoir : à l’échelle locale, ils tissent de véritables communautés d’entraide. Ils offrent un soutien émotionnel, une assistance matérielle et un sentiment d’appartenance dans des contextes de précarité et de déracinement. Ce tissu social joue un rôle de refuge et d’identité — et c’est précisément là que réside une grande partie de sa force d’attraction.
Cependant, derrière cette solidarité apparente se cache une profonde contradiction : les mêmes élites qui promeuvent ce modèle utilisent la foi comme un instrument de contrôle, détournant le potentiel transformateur des communautés pour les soumettre à une tutelle néocoloniale déguisée en aide spirituelle.
Dans ce système, l’adhésion ne se limite pas à la doctrine : elle est aussi économique et sociale. Appartenir à la communauté signifie accéder à des réseaux d’emploi, de crédit, de consommation et d’entraide. En revanche, s’en écarter ou remettre en cause ses dogmes revient à subir une forme d’« excommunication civile », une mort sociale et économique au sein même du cercle communautaire.
Comme on l’observe dans d’autres structures d’obéissance fermées, ailleurs dans le monde — en Espagne, par exemple, avec des organisations telles que l’Opus Dei ou les Témoins de Jéhovah —, celui ou celle qui s’écarte de la ligne ou conteste l’autorité est mis au ban. Marginalisé, expulsé, il se voit privé du réseau de relations et de ressources qui autrefois le soutenait. Dans le cas de l’Opus Dei, dont les institutions éducatives s’étendent jusqu’à l’université, « le dissident » ainsi écarté peut même voir son parcours scolaire ou professionnel effacé, comme l’a relaté le journal El País.
De la même manière, en Amérique latine, le pouvoir disciplinaire de ces micro‑communautés consolide le contrôle idéologique à la base, reproduisant à l’échelle du quotidien la même logique de dépendance et de soumission qui, à grande échelle, sert les intérêts politiques et géostratégiques du Nord.
Ainsi, la question posée par ces nouvelles confessions — qui, en à peine un siècle, ont relégué au second plan l’ancien catholicisme romain en Amérique latine — n’a rien de paranoïaque ni de complotiste. Elle relève au contraire d’un acte de lucidité politique et d’un nécessaire réflexe de précaution pour la sauvegarde de la souveraineté des peuples.
Si l’on veut être précis : l’évangélisme, dans ses multiples branches pentecôtistes, néo-pentecôtistes et charismatiques — rejoints par les Mormons, les Baptistes du Sud et d’autres Églises issues des matrices nord‑américaines — constitue‑t‑il une arme douce de domination ? Les faits, sans ambiguïté, tendent à le démontrer. Et cette réalité, on la connaît depuis longtemps.
Sous le discours de la « salut individuel » et de la « prospérité divine », ces courants ont tissé un maillage transnational de pouvoir spirituel et médiatique, financé et protégé par des intérêts politiques du Nord. Entre bénéfices partagés, influence géopolitique pour Washington et puissance, impunité fiscale et expansion culturelle pour ces Églises, s’est érigé tout un système de contrôle indirect qui pénètre les quartiers, les parlements et les consciences.
Ce qui pouvait sembler une simple rénovation religieuse se révèle en réalité comme un projet d’ingénierie sociale : un mécanisme de domestication morale remplaçant l’ancienne théologie de la libération par une théologie de la soumission. Au nom de Dieu, on désactive la pensée critique ; au nom de la foi, on perpétue le statu quo. Et sous le voile lumineux de la croix, on étouffe — une fois de plus — le droit de l’Amérique latine à se penser et à se gouverner elle‑même, jusque dans son espace le plus intime : celui de la conscience spirituelle.
Dans un monde en marche vers la multipolarité, la bataille pour l’âme du Brésil se joue aussi sur les pupitres des églises.
Même si ce pays concentre l’attention, il ne faut pas oublier que le phénomène s’étend à tout le continent : l’évangélisme aligné sur les intérêts du Nord progresse dans le vide laissé par l’effritement de l’ancienne hégémonie catholique.
Tant que ces Églises — et ici, il faut parler uniquement de celles qui ont fait de la foi un outil manifeste de pouvoir — continueront de gagner du terrain, l’ombre de ce nouveau colonialisme, vieux déjà d’un siècle, mais désormais drapé de ferveur religieuse, continuera de s’étendre sur l’Amérique latine.
Pourquoi est‑il nécessaire de le dire, ou au moins d’en douter, à ce moment de l’histoire ? La réponse est simple : la foi a été instrumentalisée, transformée en arme et en outil psychologique. Non pour « sauver des âmes », ni pour favoriser l’émancipation spirituelle, ni même pour rapprocher ceux qui cherchent sincèrement Dieu ; mais pour soumettre. Non pour libérer, mais pour domestiquer.
Ainsi, sous l’apparence de la rédemption, l’Amérique latine redevient un champ de mission — non de âmes perdues, mais de souverainetés en péril —, manœuvrées avec la subtilité des toiles d’araignée et des dispositifs du pouvoir impérial 2.0.
Car leur action, comme leur prédication, ne se limitent plus au temple : elles circulent aussi dans les plateformes numériques et les algorithmes orientés, multipliant leur portée et leur emprise sur des communautés entières.
Traduit de l’espagnol par Bernard Tornare